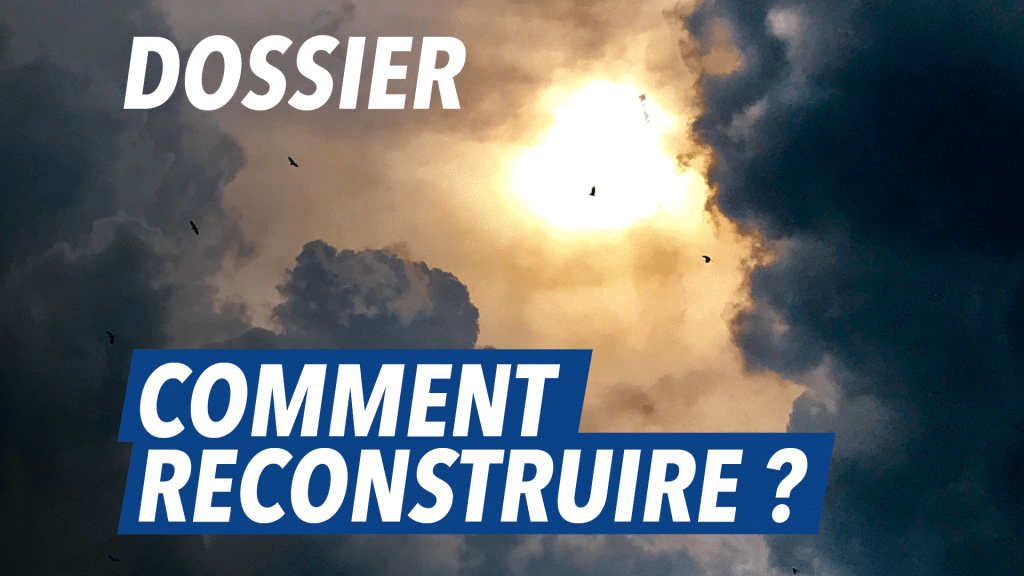Mettre l’administration au service de l’éducation civique
Si l’enseignement de l’Éducation morale et civique (EMC) constitue, dès la IIIème République, une brique essentielle de l’édifice social, il semble désormais en crise. En effet, après avoir connu de multiples modifications programmatiques et horaires tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, l’EMC recouvre aujourd’hui un contenu si large, et des pratiques pédagogiques si incertaines, qu’il est possible de douter de sa réelle efficacité. Pour résorber la fracture qui prévient l’adhésion d’une partie des citoyens aux valeurs du contrat social, nous proposons, outre une augmentation du volume horaire d’enseignement de l’EMC, une mesure forte : mettre l’administration au service de l’instruction civique. Sur l’ensemble du territoire français, les agents publics exerçant des fonctions d’encadrement pourraient, selon des modalités contraignantes ou non, dispenser aux élèves des cours sur le fonctionnement des institutions, les valeurs républicaines et les fondamentaux de la culture politique. Un tel dispositif réaffirmerait le rôle de l’État dans l’éducation, tout en revalorisant son image auprès de la jeunesse. Introduction L’Éducation morale et civique (EMC) est en crise autant qu’elle est en vogue : en crise, d’abord, car son contenu demeure mal délimité, son volume horaire de plus en plus réduit et les pratiques pédagogiques qu’elle offre mal saisies par le corps professoral ; en vogue, d’autre part, en ce qu’elle fait, depuis plusieurs décennies, l’objet d’incessantes réformes visant à l’adapter aux nouveaux enjeux de la société et qu’elle constitue, pour cause, une réponse fourre-tout pour les crises politiques et sociales que traverse le pays. Toutefois, l’excroissance des programmes de l’EMC, autant que leur difficile applicabilité, suppose de repenser les modalités de son fonctionnement. Cette nécessité est d’autant plus prégnante que les signes d’une crise de la défiance à l’égard des institutions et des valeurs de la République sont chaque jour plus visibles, notamment au sein des couches les plus jeunes de la population. Face à l’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui l’EMC, il apparaît nécessaire d’imaginer une politique publique nouvelle et simplifiée. Tandis que les professeurs font part de leur dénuement face à la diversité des outils pédagogiques dont ils disposent et la complexité inhérente à leur mise en œuvre, nous proposons qu’une partie de leurs enseignements soit prise en charge par des agents publics exerçant des fonctions d’encadrement au sein de l’administration. En effet, l’agent public pourrait illustrer auprès des élèves, à partir d’expériences éprouvées dans le cadre de ses fonctions, les valeurs de la République en action : ici, un juge parlant des droits de l’homme ; là, un commissaire de police parlant de l’ordre public ; ailleurs, enfin, un sous-préfet parlant de la laïcité. La présente note vise en conséquence à rappeler le rôle historique et philosophique de l’EMC en République, mettre en lumière les principaux maux dont elle souffre et détailler les modalités concrètes de notre proposition. I. Une instruction civique placée en première ligne du combat pour l’école républicaine Dans un discours prononcé à Bordeaux le 16 novembre 1871, Léon Gambetta, père fondateur de la IIIème République, se demande : « Comment admettre que des hommes qui ne connaissent la société que par le côté qui les irrite […] ne s’aigrissent pas dans la misère et n’apparaissent pas sur la place publique avec des passions effroyables ? ». Et le tribun d’ajouter : « Je déclare qu’il n’y aura de paix, de repos et d’ordre qu’alors que toutes les classes considéreront leur gouvernement comme une émanation légitime de leur souveraineté et non plus comme un maître avide et jaloux »[1]. L’instruction civique est née : avec la loi Ferry du 28 mars 1882, l’éducation morale et civique de l’élève figure au premier rang des apprentissages de l’école primaire, devant l’écriture et la lecture. Son initiateur, Jules Ferry, rappelle devant le Sénat, le 10 juin 1881, l’intérêt primordial qu’elle revêt pour la constitution d’une société républicaine, au lendemain de la tourmente de Sedan et de la destitution de Louis-Napoléon Bonaparte, mais aussi de l’épisode de la Commune : « Si vous voulez chasser des esprits les utopies, si vous voulez émonder les idées fausses, il faut que vous fassiez entrer dans l’esprit et dans le cœur de l’enfant des idées vraies sur la société où il doit vivre, sur les droits qu’il doit exercer. Comment ! dans quelques années, il sortira de l’école primaire – et pour un grand nombre de ces jeunes gens, c’est à l’école primaire que s’arrêtent malheureusement et se limitent tout le bagage et toutes les connaissances scientifiques. Comment ! il sera électeur dans quelques années et vous voulez nous défendre de lui apprendre ce que c’est qu’une patrie ! »[2]. Les valeurs alors enseignées, à la fin du XIXème siècle, sont proprement conçues pour garantir une adhésion totale et collective des élèves de l’école primaire au modèle républicain : il est ainsi question du service militaire, de la foi dans le progrès, du patriotisme et de l’obligation fiscale[3]. A. Aux origines historiques et théoriques d’une instruction civique universelle Son intérêt, dans l’esprit de ses promoteurs, est double. L’instruction civique assure, en premier lieu, de faire vivre effectivement la démocratie en diffusant un corpus de principes et de valeurs communs chez les plus jeunes. La démocratie n’est, en effet, pas qu’une convocation régulière à voter : elle est, comme l’écrit Pierre Mendès-France, « un type de mœurs, de vertu, de scrupule, de sens civique, de respect de l’adversaire »[4]. Ce type de mœurs spécifique est institué par le maître d’école, qui convainc les élèves d’une pratique partagée et sans cesse renouvelée du débat et de la délibération. Octave Gréard, le Vice-recteur de l’Académie de Paris jusqu’en 1877 et créateur des premiers lycées de jeunes filles, écrivait ainsi dans un Cours de pédagogie théorique et pratique à destination des professeurs des écoles : « Ce que le bon sens demande, c’est qu’au respect des traditions nationales, qui est la base du patriotisme éclairé, se joigne dans l’esprit des enfants, arrivés, comme on dit, à l’âge de raison, la connaissance des lois générales de la vie publique de leur pays. Ce que nos élèves savent le moins, c’est ce qu’ils
Par Klotz P.
25 juillet 2023