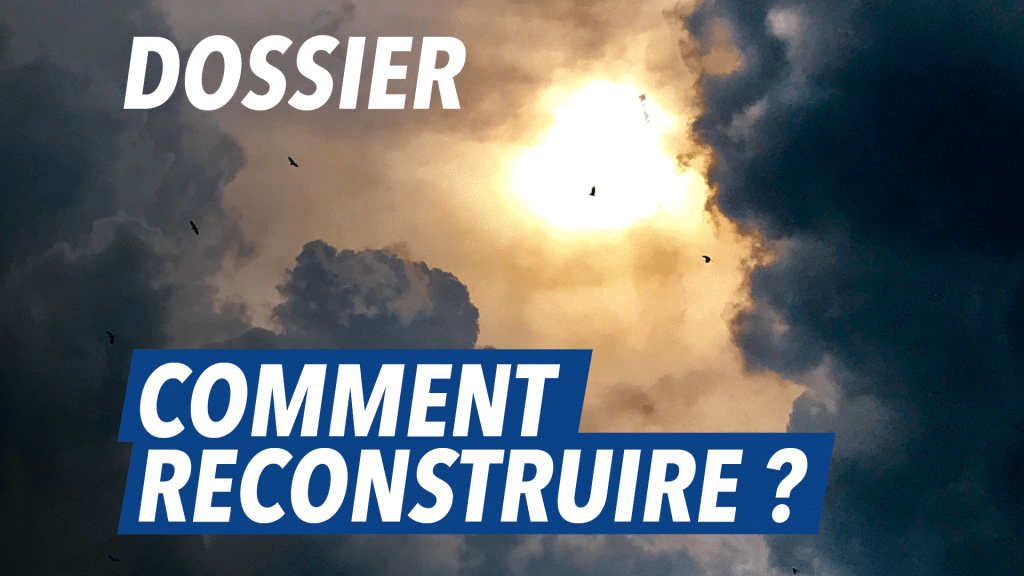Communiqué Institut Rousseau
Pour la première fois depuis la Libération, l’extrême-droite semble en mesure d’obtenir une majorité parlementaire et, ainsi, de gouverner notre République. L’histoire nous apprend pourtant que l’extrême-droite ne dit jamais son nom, pas plus que l’extrême-libéralisme, et que les deux vont souvent de pair. Au cours des trente dernières années, ces forces se sont conjuguées pour nous mener aujourd’hui au bord de l’abîme. Alors que l’idéologie du marché sans contrepartie abattait les protections des individus, des nations et des écosystèmes, préparant l’avènement de l’extrême-droite tout en prétendant la repousser, cette dernière s’appuyait sur le désordre du monde et la colère grandissante pour imposer ses visions rétrogrades et simplistes et accuser ses boucs-émissaires. Ces deux puissances masquées se sont renforcées et soutenues mutuellement, pour le plus grand malheur des peuples qui croient en leurs promesses de prospérité ou d’ordre, alors qu’elles n’apportent que précarité et désordre. Sous couvert de « modernité » ou de « protection », leurs logiciels profonds sont ceux de la violence et du ressentiment. Ces forces ne parlent pas le langage de la République : à rebours de l’idéal d’humanisme et de solidarité, elles opposent les citoyens entre eux, selon leur statut social, leurs origines ou leurs manières d’être. Ce ne sont pas des forces de progrès, de protection, encore moins de rassemblement, ce sont des forces de destruction, d’insécurité et de division. Les fictions sociales sur lesquelles elles reposent nient tant la possibilité d’une alternative au repli identitaire que celle d’une harmonie, c’est-à-dire qu’elles refusent ce qui constitue l’essence même de la liberté humaine. Le résultat de leur action, dans les actes comme sur les esprits, est devant nos yeux : nous vivons un âge des colères, celui où l’équilibre psychologique et la tolérance des peuples menacent de céder devant la disparition des services publics et des solidarités organisées, devant la montée des inégalités, de la pauvreté et la violence sociale qui en découle, comme devant la violence des représentations et la déshumanisation des débats publics. Placés en situation permanente d’insécurité économique, soumis à un ordre de réformes aussi injustes que prétendument incontournables, contraints et punis dans leur expression politique, appelés à se dresser contre les plus faibles plutôt que d’être solidaires à leur égard, de plus en plus de nos concitoyens se préparent ainsi à faire le choix du pire, sans comprendre que cela les conduira vers davantage de difficultés encore. Il n’est plus d’intelligence rationnelle là où la souffrance et la frustration dominent trop longtemps. Pourtant, différentes enquêtes récentes ont montré que plus des trois-quarts des Françaises et des Français s’accordent pour des réformes telles que l’abrogation de la réforme des retraites, l’augmentation du SMIC, le rétablissement de l’ISF, la revalorisation de nos services publics ou encore la mise en place d’une véritable planification écologique capable à la fois de réindustrialiser notre pays et de répondre à la crise climatique. Ni le Rassemblement National –qui hier encore renonçait à abroger la réforme des retraites ou à rétablir l’ISF–, ni les partisans de la poursuite d’une politique néolibérale dont l’application n’a eu d’autres effets que diviser notre Nation, affaiblir notre économie et accélérer la régression écologique ne sont en mesure de répondre à ces aspirations majoritaires. Il appartient ainsi à toutes les forces sociales, républicaines et écologistes de convaincre le peuple, tout le peuple, qu’une autre voie est possible. Que l’on peut apporter des réponses crédibles, ambitieuses et justes à des problèmes bien réels, que la prospérité, la sécurité des individus comme la protection de la nature ne s’opposent pas mais sont indissociables, que l’on peut susciter l’adhésion politique par l’espoir plutôt que par le ressentiment ou la peur, qu’il n’y a pas de fatalité au repli ou à un ordre du monde perverti par une logique capitaliste déshumanisée. L’Institut Rousseau est né de cette conviction il y a plus de quatre ans, et il tiendra son rôle au service de cet idéal dans cette période critique. En écho à la Déclaration de Philadelphie (1944), nous soutenons que la justice sociale est le meilleur garant de la paix. Dans le sillage du Préambule de notre Constitution, nous affirmons que les droits humains de tous, y compris les migrants, ne sont jamais et nulle part négociables. Enfin, dans le prolongement de l’Office International du Travail, ultime témoin du projet de Société des Nations, nous affirmons que chacune, chacun a droit à un travail décent. Forts des travaux que nous avons produits au cours de ces dernières années, et des propositions originales que nous avons souvent fait émerger, nous entendons ainsi contribuer à montrer que sur les grands sujets politiques du moment, des solutions existent, qui n’ont besoin que de volonté politique et de l’engagement des citoyens à les revendiquer pour devenir des réalités. Nos propositions feront ainsi écho à celles qui se construisent dans le champ politique et syndical, en réaction à cette situation politique dangereuse, du Front populaire aux acteurs de la société civile, et seront utiles à toutes celles et tous ceux qui sont engagés pour le renouveau démocratique, la reconstruction écologique et la justice sociale. Notre contribution se matérialisera, à partir du 20 juin, par la publication quotidienne, durant deux semaines, de propositions synthétiques offrant des solutions concrètes et innovantes, dans le domaine des institutions politiques, de la protection sociale, du renouveau économique et de la reconstruction écologique. Rendez-vous à partir du 20 juin ! Institut Rousseau – des idées pour la reconstruction écologique, sociale et républicaine de nos sociétés.
16 juin 2024