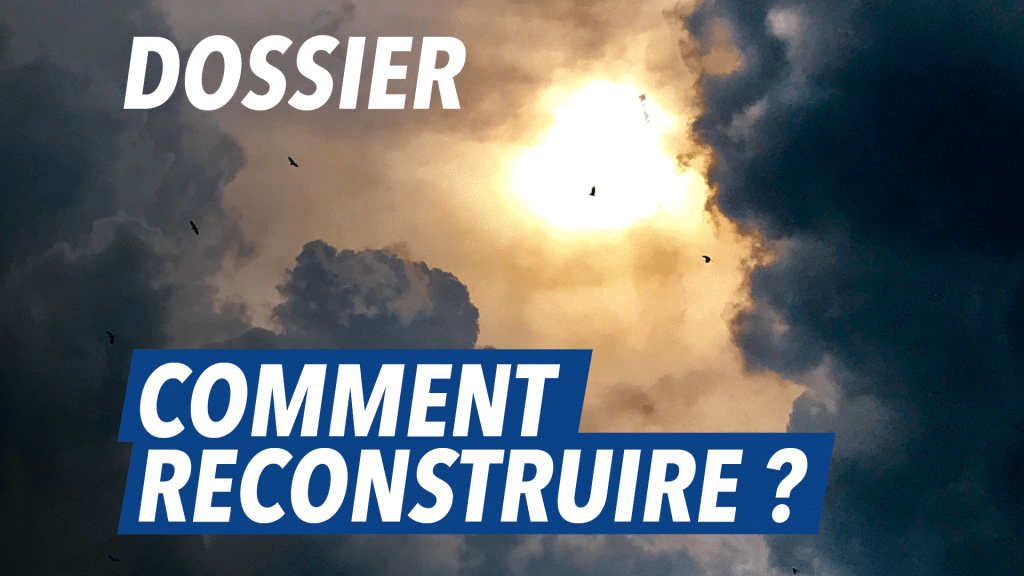L’écologie, combat du siècle ? La transformation de la finance n’a pas eu lieu
On peut lire sur une page du site de l’Élysée nommée « L’écologie, combat du siècle » que le gouvernement a pour « ambition […] une transformation en profondeur de la finance privée »[1] dans le sens d’une meilleure prise en compte des enjeux climatiques. De nombreuses initiatives en faveur de la finance durable ont ainsi été lancées au cours du quinquennat. Deux commissions Climat ont été créées au sein des régulateurs bancaires et des marchés financiers, dont l’objectif principal est le suivi des engagements des institutions financières françaises. L’État a également contribué à la promotion de Finance for Tomorrow, un consortium d’institutions financières principalement privées, notamment à travers son soutien au lancement de l’Observatoire de la Finance Durable, dont le rôle est là encore de réaliser le suivi des pratiques et engagements des acteurs financiers. L’action du quinquennat en faveur de la finance durable s’est soldée par la publication du rapport Perrier, du nom du président d’Amundi, rédigé à la demande du ministre de l’Économie afin de présenter des pistes de renforcement de la finance durable. Sur le plan réglementaire, l’action a principalement été menée au niveau européen. On compte notamment le règlement « Disclosure », qui décline les obligations de transparence quant à la prise en compte des enjeux climatiques. Il a été transposé en France par l’article 29 de la loi énergie-climat en 2019. L’État a également facilité l’accès aux offres d’épargne verte à travers la loi Pacte. L’ensemble de ces actions, détaillées par Philippe Zaouati en introduction de cette série[2], est-il en mesure d’engager « une transformation en profondeur de la finance privée » ? Au prisme de notre analyse, il apparait fortement insuffisant. Cette note se propose d’appréhender les mécanismes qui compromettent aujourd’hui la durabilité de la finance, et singulièrement sa capacité à tenir compte du réchauffement climatique et de la transition bas-carbone. À notre sens, la finance durable doit reposer sur deux piliers, conditionnant les leviers permettant de faire des agents financiers des acteurs de la transition. D’une part, la finance doit être en mesure d’identifier les risques associés au réchauffement climatique (risques physiques) et à la transition écologique (risque de transition). On montrera que cela est impossible sans une action franche de l’État, du fait de l’incertitude radicale, dite knightienne, associée à ces risques. Il s’agit en somme de prendre acte du fait que le mécanisme d’évaluation des risques/rendements est défectueux en présence de telles incertitudes, et de supplanter ce mode de coordination par un rôle accru de l’État. D’autre part, elle doit tenir compte de ces risques une fois ceux-ci mis au jour par l’action de l’État. La domination des stratégies d’investissement de court terme, ou spéculatives, sur les marchés financiers l’empêche. Cela est une conséquence de l’excessive liquidité[3] des marchés, résultat de décennies de libéralisation financière. Nous montrerons que les actions visant à rendre la finance durable ne peuvent aboutir si elles ne s’inscrivent pas dans un mouvement plus large de réglementation et de cloisonnement des marchés, qui obligerait les investisseurs de tenir compte des enjeux de long terme. I) Mise en perspective des réformes en faveur de la finance durable privée : un ancrage néo-libéral franc A. L’efficacité limitée d’une approche par l’incitation pour encadrer une « défaillance de marché » Les actions du dernier quinquennat en matière de finance durable sont caractérisées par leur ancrage idéologique profondément néo-libéral. Fidèles à la doctrine selon laquelle la liberté économique et le libre jeu de l’entreprise ne doivent pas être entravés, ou le moins possible, les mesures gouvernementales ont eu pour objectif principal d’inciter les acteurs financiers à s’orienter vers une finance dite « verte ». L’architecture réglementaire actuelle fait principalement appel au bon vouloir des acteurs financiers. L’efficacité de cette approche se heurte toutefois à des limites profondes : l’incapacité d’une finance déréglementée et autorégulée à prendre en compte les enjeux écologiques. Ainsi, les efforts français et européens en matière de finance durable se sont concentrés sur des objectifs de transparence de l’information, formant ainsi l’hypothèse que l’accès à l’information permettrait aux acteurs des marchés financiers d’intégrer spontanément les exigences environnementales dans leurs stratégies d’investissement. L’article 29 de la loi énergie-climat sur le reporting extrafinancier des acteurs de marché est censé garantir la publication systématique des modalités de prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les politiques d’investissement et les procédures de gestion des risques, tout en incitant à la prise en compte des risques climatiques. Cependant, ce type d’approches qui met l’accent sur la publication des données relatives au climat se fonde sur l’hypothèse implicite selon laquelle une fois les risques pleinement révélés, les acteurs financiers répondront de manière rationnelle et alignée sur l’intérêt public. Cette conception trouve ses racines dans « l’hypothèse des marchés financiers efficients », appliquée au secteur financier et à sa perception de la politique climatique2. Cette approche ne saurait toutefois être considérée comme un moyen suffisant pour encadrer le comportement des acteurs financiers : en effet, le dérèglement climatique est encore souvent perçu comme une externalité économique, c’est-à-dire que les investisseurs considèrent que les conséquences environnementales néfastes de leurs décisions d’investissement n’affecteront pas directement la rentabilité de leur portefeuille. Les acteurs financiers transfèrent le coût des risques environnementaux de leurs décisions à la société dans son ensemble et sur les générations futures au-delà du court terme qui régit leurs performances. Il s’agit ici d’un cas d’aléa moral, vecteur de déresponsabilisation des investisseurs qui ne supportent pas le coût de leurs actions, qui souligne la limite majeure de l’hypothèse selon laquelle les acteurs financiers ajusteront leur comportement dans le sens d’un alignement avec les objectifs de préservation du climat. Cela est d’autant plus vrai que les enjeux environnementaux tombent dans la catégorie des défaillances de marché[4] à de multiples égards, c’est-à-dire qu’ils relèvent d’une situation dans laquelle le marché concurrentiel ne peut réguler efficacement les activités économiques. La responsabilité fiduciaire des gestionnaires d’actifs illustre bien la manière dont cette défaillance de marché grève les capacités des acteurs financiers à rendre leurs comportements plus vertueux. Le rôle juridiquement défini des gestionnaires d’actifs est d’optimiser le rendement du risque financier des actifs sous gestion,
Par Driouich R., Saviuc A.
13 avril 2023