Une maîtrise démocratique de l’urgence : comment respecter les libertés publiques en temps de crise ?
La réponse des gouvernements français et mondiaux à l’épidémie de Covid-19 a été marquée par une restriction des libertés individuelles sans équivalent en temps de paix, que ce soit en ampleur ou en durée…
Lire la suite…
Une fonction publique solide, revalorisée et plus diverse pour vivre bien
À l’instar du juriste Léon Duguit, on peut concevoir l’État comme « une fédération de services publics ayant pour objet d’organiser la société et d’assurer son fonctionnement pour le bien commun[1] »…
Lire la suite…
Le coronavirus, des enseignements à tirer pour sortir d’une démocratie déjà confinée
L’apport de cette note tient au constat d’une démocratie[1] déjà confinée, appréhendée par les gouvernants dans sa dimension purement majoritaire et formaliste. L’épisode révélateur de l’organisation du premier tour des élections municipales à l’aune d’une crise sanitaire permet d’attester de la déconnexion des sphères politique et sociale…
Lire la suite…
Un Parlement confiné ?
La crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui soulève rétrospectivement trois niveaux de questions, à court, moyen et long terme. Sur le long terme, la question est d’ordre civilisationnel…
Lire la suite…
Retour sur le « retour de l’État »
Dans la préface de 1963 de son ouvrage La notion de politique[1], Carl Schmitt[2] déclarait de façon pour le moins inattendue que « l’ère de l’État [était] à son déclin ». Du point de vue de la France gaullienne et planificatrice, la formule avait de quoi sembler saugrenue…
Lire la suite…
Réduire la vulnérabilité de notre économie aux aléas des marchés financiers
Bien que la crise du Coronavirus ne soit pas une crise d’origine financière, elle a révélé des fragilités profondes des marchés financiers et une interdépendance en grande partie non-désirable avec l’économie réelle…
Lire la suite…
Gérer les grandes infrastructures dans l’intérêt commun en période de crise
Essentielles dans le cadre du développement économique et social des sociétés industrialisées, les grandes infrastructures constituent un patrimoine collectif aujourd’hui invisible aux yeux des populations et dont les services délivrés sont devenus bien acquis…
Lire la suite…
« Le coronavirus, des enseignements à tirer pour sortir d’une démocratie déjà confinée ».
L’apport de cette note tient au constat d’une démocratie [1] déjà confinée, appréhendée par les gouvernants dans sa dimension purement majoritaire et formaliste. L’épisode révélateur de l’organisation du premier tour des élections municipales à l’aune d’une crise sanitaire permet d’attester de la déconnexion des sphères politique et sociale. Il y a urgence à repenser un nouveau paradigme démocratique pour « l’après », l’ère de la démocratie délibérative large multi-niveaux, associant les citoyens et la société civile au maximum dans une logique englobante.
Table des matières.
I- Constater : une démocratie « en crise » déjà confinée.
II- Repenser : l’urgence d’acter un paradigme démocratique dit « délibératif ».
III- Concrétiser : concevoir de nouveaux modèles de gestion s’appuyant sur le citoyen en temps normal et en période de crise.
I- Constater : une démocratie « en crise » déjà confinée.
« En même temps », ce leitmotiv présidentiel confus se révèle lourd de sens dans cette crise pandémique. Le maintien des élections municipales au sein de cette crise sanitaire en atteste aisément. Le premier tour des élections municipales en date du 15 mars n’a pas été reporté, pourtant, la veille du scrutin, le Premier ministre annonçait la fermeture de l’ensemble des lieux non essentiels à la vie de la Nation. Les médecins en appellent au report face à un gouvernement aux propos antinomiques : « restez chez vous mais en même temps, allez voter ». Cet épisode, a priori anecdotique, constitue le parfait corollaire de la perception démocratique actuelle, une conception étroite et « confinée », purement formaliste. Quoi de plus révélateur d’une autonomisation exacerbée du champ politique conduisant à une isolation vis-à-vis de la sphère sociale ? Une réelle tension se joue alors car le citoyen se voit contraint de choisir entre acte politique et acte social : son devoir de voter d’un côté, son devoir de se protéger ainsi que ses pairs de l’autre.
Sans grand étonnement, les élections municipales ont fait l’objet d’une abstention record s’élevant à plus de 55,25% contre 36,5% en 2014. Logiquement, ces maires ayant acquis leur élection de droit au premier tour par une majorité absolue des voix, la conserveront, tel en dispose la loi du 23 mars 2020 relative à l’État d’urgence sanitaire [2]. Il faut dire que le Conseil constitutionnel, juge du scrutin, fait d’ordinaire fi de ces considérations : l’abstention versus vote est un choix, celui de ne pas aller voter et ne peut emporter de conséquences sur le scrutin lui-même [3]. Or, et c’est tout le problème, ces circonstances exceptionnelles d’espèce entourant le vote ne font pas l’objet d’un choix citoyen consenti mais contraint : ne pas voter pour se protéger soi, ses proches, les autres. La sincérité du scrutin peut dès lors être altérée dans cette « démocratie pandémique », l’égalité des citoyens devant le suffrage remise en cause. Une pétition en ligne, intitulée « Je n’ai pas pu choisir mon maire à cause du coronavirus », a déjà pu recueillir presque 13 000 signataires. Quoi qu’on en dise, la légitimité démocratique de ces « élus-covid » dès le premier tour est branlante, sans parler de ceux « post-covid », convoqués pour un second tour, éligibles par une déconnexion de plusieurs mois entre le premier et le second tour de scrutin, rendant « celui-ci » ou pourrait-on dire (après plusieurs mois) « ceux-là », insincères.
Concrètement, c’est notre attachement à la démocratie que le coronavirus pointe : une démocratie majoritaire, où seule importe la capacité de gouverner, où seul le vote compte et prime, qu’importe les circonstances pandémiques ; malgré l’absence de visibilité du débat public obnubilé par la crise sanitaire et l’impossibilité vitale pour certains de se rendre aux urnes. La démocratie se conçoit uniquement comme un instrument de légitimation purement formel des gouvernants, l’essentiel étant la nomination d’exécutifs locaux à n’importe quel prix, faisant fi du reste. Cette conception hyper représentative et déconnectée du social n’échappe pas aux yeux des citoyens. La gestion de la crise en général, de même que l’avant ou l’après, relève du « clair-obscur ». Les derniers sondages du CEVIPOF [4] sont édifiants : 57% des français ont la vision d’une démocratie qui ne fonctionne pas bien contre 30% en Allemagne ou 26% au Royaume Uni. Surtout, 77% des français ont le sentiment que les gouvernants ne tiennent pas compte de leurs opinions contre 46% en Allemagne et 49% au Royaume-Uni. La gestion très bonapartiste de la crise conduit à repenser la conception de la représentation à la française : qu’il s’agisse de l’inclusion du citoyen dans la gestion de crise mais surtout après. Gardons-le à l’esprit, l’organisation des municipales, certes, constitue un dysfonctionnement démocratique important, mais cela ne fait que révéler un constat pré-établi : une démocratie strictement « majoritaire », coupée de ses citoyens. Paradoxalement, le discours du Premier ministre Édouard Philippe, en date du 28 avril dernier, sur le plan de déconfinement atteste même de cette démocratie purement formaliste envers les représentants : « Non. Les députés ne commentent pas : ils votent ».
II- Repenser : l’urgence d’acter un paradigme démocratique dit « délibératif ».
En réalité, cette démocratie de « crise » en « crise » s’enracine dans un besoin plus profond encore : celui d’un changement de paradigme démocratique, responsable de la crise de la représentation. Élire, mandater, obéir : la démocratie à la française se révèle l’archétype du système « top-down » par excellence. Ce type de démocratie revêt une forme représentative, élitiste, en déléguant aux seuls « présumés capables » la tâche de définir ce qu’est l’intérêt général. Dès lors, selon Francis Dupuis-Déri, l’élection s’apparenterait à une sorte de procédure d’auto-expropriation du peuple de son pouvoir, confié uniquement aux élus. Or, à l’ère du « netizen » (citoyen hyper-connecté), « l’assentiment populaire préalable ne suffit plus. La légitimité ne provient plus de l’organe mais du processus décisionnel lui-même ». Comme l’exprime à juste titre Bernard Manin, l’idéal « démocratique » moderne ne consiste plus en « la décision de tous mais dans la délibération de tous » [5]. Cette vision délibérative englobante de la démocratie, viendrait résoudre les critiques formulées par Clément Viktorovitch, politiste, à l’égard de l’institution parlementaire. Celui-ci a pu démontrer en effet que « les contradictions jacobines et sieyessiennes » mettent à mal, dans son fondement même, la légitimité du Parlement sous plusieurs aspects : d’une part, « tout en prétendant incarner l’unité derrière l’intérêt général, le Parlement institutionnalise le pluralisme » et donc serait vecteur de « plusieurs interprétations incompatibles de la volonté populaire » [6]. D’autre part, si le Parlement procède du peuple, il détient de jure le monopole de l’élaboration de la législation et le peuple se retrouve ainsi « limité à la simple capacité de surveillance et d’empêchement » [7]. Le système politique basé une approche délibérative englobante viendrait résoudre ces paradoxes inhérents. Par ce mode de fonctionnement, les parlementaires seraient de facto incités à respecter la force du meilleur argument, ce « rapprochement progressif des opinions divergentes au fur et à mesure que le débat se poursuit » [8]. Ce ne serait donc plus « un pluralisme irréductible et agnostique » [9] mais la recherche collective de l’intérêt général.
À l’aune de cette crise de la représentation irriguant l’État français ces dernières décennies, il est temps d’acter l’ère d’une démocratie plus délibérative que majoritaire, une démocratie plus consensuelle que compromissoire. Quelle meilleure conjoncture que celle de « l’après Covid » pour ce faire? [10] Après l’expérience d’un individualisme effacé au profit de l’intérêt général, quand se protéger soi, c’est également et surtout, protéger les autres. L’intérêt général, bien conçu, est celui de l’intérêt de tous, il passe par la délibération, par des mécanismes d’inclusion délibératifs. Après l’expérience dite du « Grand débat national », il faut aller encore plus loin, pour ouvrir l’ère de la démocratie délibérative large multi-niveaux, associant les citoyens au maximum dans une logique englobante. Dès lors, plusieurs stratégies pratiques pourraient se mettre en place pour relégitimer le processus législatif à travers le citoyen, reflétant le passage à une nouvelle culture démocratique. Cela passe par un contrôle accru qui renforce le citoyen dans sa faculté de surveillance et d’empêchement (notamment sa capacité de défaire la loi via le veto), et par une élaboration législative plus ouverte, allant vers l’avènement d’un citoyen co-législateur constructif (par le biais d’initiatives citoyennes ou de grandes consultations).
III- Concrétiser : concevoir de nouveaux modèles de gestion s’appuyant sur le citoyen en temps normal et en période de crise.
Un premier pas avait déjà été amorcé avant cette crise via la Convention citoyenne pour le climat. Il prend encore plus sens aujourd’hui. Les 150 citoyens tirés au sort [11] ont planché sur l’après Covid-19, lors d’une session extraordinaire de travail menée les 3 et 4 avril derniers par visioconférence. Pour l’assemblée citoyenne, « la stratégie de sortie de crise, devra porter l’espoir d’un nouveau modèle de société […]. Un modèle économique et sociétal différent, plus humain et plus résilient face aux futures crises ». Elle poursuit : « La participation citoyenne est essentielle. […] C’est le moment idéal d’écouter et de prendre en compte les remarques des citoyens pour la construction d’une société future ». Cette expérience pourrait-on dire hasardeuse puisque amorcée bien avant la crise sanitaire, pourrait enclencher des efforts de réflexion sur l’implication des citoyens en période de crise, pour en sortir, et afin d’anticiper les prochaines.
Ce mode de fonctionnement permet de s’attarder sur deux autres formes délibératives à savoir les « jurys citoyens » et la « Chambre du futur ». Cette dernière, contrairement à la Convention citoyenne pour le climat constitue une sorte de troisième chambre au long terme, composée des représentants de la société civile ayant pour rôle celui d’une instance unique de consultation de fabrique de la loi associant les citoyens par de larges consultations. Pour autant, si Emmanuel Macron s’est engagé à renoncer aux 60 personnalités associées, les membres de l’ancien CESE rebaptisé « conseil de la participation citoyenne » dans le projet de loi constitutionnelle continueront à être choisis parmi des représentants la société civile. Les jurys citoyens, pour leur part, se rapprochent davantage du mécanisme de la convention citoyenne pour le climat. Ils s’apparentent certes à un dispositif ponctuel mais intéressant : une vingtaine de citoyens tirés au sort dans le respect de la diversité (à défaut d’être représentatifs) sont associés à la confection de la loi sur un thème. Ils élaborent un rapport motivé et disposent à ce titre d’un éventail de mécanismes « d’aide à la décision » : procédure d’enquête, experts… Certes, l’organisation de la délibération est quelque peu « artificielle », mais l’ensemble des enjeux sont exposés dans une dynamique chaque fois contradictoire. Le rapport émis par ce jury citoyen se veut, de facto, parfaitement éclairé.
Proposition n°1 : Poursuivre l’effort de création d’une véritable « chambre du futur » de consultation (tel le Conseil de la participation citoyenne contenu dans le projet de loi constitutionnelle) composée de plusieurs collèges y compris de citoyens tirés au sort. Elle œuvrera, certes en dehors de la crise mais également en période de crise, pour en sortir, et afin d’en anticiper les prochaines.
Proposition n°2 : Faire appel à des dispositifs ponctuels de « jurys citoyens » tirés au sort pour les associer à la confection de la loi sur un thème et ce, aussi bien en période de crise qu’en dehors. La Convention citoyenne pour le climat en constitue une preuve d’efficience à grande échelle.
Au-delà de ces « jurys citoyens » ou « chambre du futur », il existe d’autres propositions permettant d’interférer directement dans le débat parlementaire.
D’une part, simplifier les procédures permettant la mise en œuvre du droit de pétition dans une perspective d’impulsion de la loi permettant de mettre l’accent sur le citoyen instigateur. Un allègement des étapes procédurales conditionnant l’examen de la pétition [12], de même qu’une obligation d’étude de celle-ci par la commission compétente semblent essentiels à partir d’un certain seuil.
D’autre part, militer pour la systématisation du droit d’amendement citoyen, prolongement du droit d’initiative législative : il consiste, pour les citoyens, à soumettre au vote des chambres des modifications aux textes dont elles sont saisies, qu’il s’agisse de projets de loi, ou de propositions de loi. Le seuil préconisé par le député Olivier Faure était celui de 45 000 signatures, collectées sur internet, afin que l’amendement soit considéré comme recevable et qu’il puisse être défendu par le rapporteur. À cet égard, il serait utile de repenser la défense de l’amendement citoyen par le rapporteur. On pourrait notamment imaginer la figure « d’un rapporteur citoyen », dont il faudrait définir les modalités. Celui-ci serait chargé de défendre les amendements citoyens retenus pour être examinés en séance publique, c’est à dire les amendements ayant reçu sur la plateforme un nombre suffisant de co-signatures. Il pourrait être un député spécialement désigné à cet effet ou bien le rapporteur du texte en question, cette dernière solution étant en pratique certainement la plus aisée à mettre en oeuvre. Sa seule obligation serait de présenter et de défendre les amendements citoyens ayant atteint le seuil nécessaire, mais il demeurerait libre de son vote et pourrait, le cas échéant, donner un avis négatif à leur adoption, comme pour tout autre amendement.
L’exemple du projet de loi sur la République numérique, d’une certaine manière, donne corps à cette ambition démocratique dans la mesure où elle a constitué la première loi co-écrite avec les citoyens. En effet, après trois semaines de consultation en ligne, l’on dénombrait 21 330 participants et 8 501 amendements et propositions.
Proposition n°3 : Simplifier les procédures permettant la mise en œuvre du droit de pétition.
Proposition n°4 : Systématiser le droit d’amendement citoyen et proposer la création d’un « rapporteur citoyen » chargé d’en défendre les amendements ayant atteint un certain seuil (a minima 100 000 soutiens pour éviter l’éventuelle pression des lobbies).
D’autres mécanismes de contrôle citoyen pourraient être mis en place tels la simplification du référendum d’initiative partagée [13] abaissant le seuil de signatures des citoyens à celui d’un million. L’exemple concernant la privatisation des aéroports de Paris a pu également démontrer la dynamique « veto » de ce genre de mécanismes. Le Conseil constitutionnel a ainsi rendu une décision sujette à critiques validant l’admissibilité d’un tel référendum entre l’adoption et la promulgation de la loi visant à empêcher son entrée en vigueur. D’ailleurs le dernier projet de réforme constitutionnelle tire les leçons de ces dérives possibles du referendum d’initiative partagée. Pourtant, le veto populaire constitue le corollaire des démocraties tournées vers le dialogue inclusif. « L’opposition étant le peuple », les partis s’acclimatent à une « culture du consensus ». Tous collaborent afin d’éviter un blocage de la loi par une sanction citoyenne. Par ce mode de fonctionnement, les parlementaires sont incités à respecter la force du meilleur argument, ce « rapprochement progressif des opinions divergentes au fur et à mesure que le débat se poursuit. Ce n’est donc plus un pluralisme irréductible et agnostique mais la recherche collective de l’intérêt général » [14].
Partant de ce constat, une phase post parlementaire s’ouvrant juste après le vote de la loi pourrait être de mise comme en Suisse, et ainsi permettre de s’opposer à son entrée en vigueur. Dans une courte période postérieure à leur adoption et avant leur entrée en vigueur (par exemple 70 jours), les lois ordinaires pourraient, à la demande d’un certain nombre d’électeurs (500 000 par exemple), faire l’objet d’un referendum portant sur leur entrée en vigueur. Dans ce cas, la loi sera soumise au vote et n’entrera en vigueur que si la majorité des citoyens l’approuvent. En revanche, ces mécanismes de type « veto » fondent leur vertu par une délibération sur le temps long. Il faudra prendre garde à l’importation d’un tel mécanisme en temps de « crise », temps basé sur l’immédiateté qui pourrait conduire à une dérive contreproductive.
Proposition n°5 : Simplifier le référendum d’initiative partagée à la fois sur ses modalités d’adoption via l’abaissement du seuil de signatures à un million mais aussi sur son mode de déclenchement : que les citoyens puissent être à l’initiative de la proposition appuyés par des parlementaires et non exclusivement l’inverse (c’est d’ailleurs le contenu du projet de loi constitutionnelle).
Proposition n°6 : Instaurer un mécanisme de contrôle citoyen type veto dans une phase post-parlementaire en dehors des périodes de crise. Dans une courte période postérieure à leur adoption et avant leur entrée en vigueur (70 jours), les lois ordinaires pourraient, à la demande d’un certain nombre d’électeurs (500 000), faire l’objet d’un referendum portant sur leur entrée en vigueur.
Conclusion
D’aucuns diront que la démocratie représentative à la française ne souffre pas de maux. En réalité, il s’agit de tirer l’alarme sur l’urgence d’une nouvelle approche démocratique englobante en réponse à un dogme autodestructeur [15] axé sur le monopole des représentants une fois l’élection passée. Opter pour une démocratie délibérative multi-niveaux permettra d’atténuer considérablement le symptôme irriguant nos démocraties occidentales : la crise de la représentation.
[1] Se prêter à penser la démocratie suppose de s’entendre sur son acception. L’étude retiendra une définition purement organique de la démocratie, à savoir tendre vers une « identité entre objet et sujet du pouvoir ». Dans une démocratie représentative, elle s’entendra comme la recherche du rétablissement du lien de confiance entre gouvernés et gouvernants en réduisant la chaîne de légitimation les séparant, en passant de « citoyens passifs » à de véritables « citoyens actifs ». Le volet consacré à la démocratie en tant qu’équilibre des pouvoirs et assurant la protection des droits fondamentaux des citoyens sera traité par d’autres contributeurs (cf notes concernant les « institutions »), à l’aune d’une crise sanitaire où les impératifs de santé publique ont percuté des principes démocratiques fondamentaux.
[2] L’article 19-1 de cette loi dispose « dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux, dès le premier tour organisé le 15 mars, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution », ce dernier dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret… » .
[3] Si le code électoral prévoit qu’au moins un quart des électeurs inscrits doit avoir voté dans les communes de moins de 1.000 habitants pour qu’une élection soit validée, il ne fixe pas de seuil de participation pour l’ensemble des communes.
[4] CEVIPOF, baromètre de la confiance politique, vague 11 bis, avril 2020.
[5] MANIN B., « Volonté générale ou délibération ? Esquisse d’une théorie de la délibération politique », Le Débat, n° 33, 1985, p. 83.
[6] VIKTOROVITCH, C., Conclusion « Le Parlement, les citoyens et la délibération » in « Le Parlement et les citoyens », Les cahiers du CEVIPOF, Olivier Rozenberg et Clément Viktorovitch (dir) , Octobre 2014, n°58.
[7] ibid.
[8] ibid.
[9] ibid.
[10] « Il peut aussi y avoir des réformes majeures, comme après 1945, et surtout, des « traces culturelles » profondes, comme après mai 1968 : sur la conscience de l’unité de destin du genre humain, y compris écologique, sur les inégalités sociales plus évidentes pendant la crise, sur la famille et le rapport à l’autre, sur la place vitale de certains métiers peu valorisés (caissières, aides-soignants…), l’idéologie économique, le rapport au temps, l’implication citoyenne », CHOURAQUI A., directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en sciences politiques et sociales.
[11] Pour assurer la meilleure représentativité, le tirage au sort est réalisé selon des méthodes de sélection conçues pour refléter celle de la société Française dans son ensemble : 51 % de femmes – 49 % d’hommes, 6 tranches d’âge conformes à population française, 6 niveaux de diplômes reflétant la structure de la population française, la diversité des catégories socio-professionnelles et tous les types de territoires, avec « cinq représentants des Outre-Mer ».
[12] Il existe actuellement deux voies de réception des pétitions : l’Assemblée nationale et le Conseil économique, social, et environnemental. Les pétitions ne sont pas toujours examinées, les délais d’examen sont excessivement longs, surtout elles sont rarement relayées. Ainsi, seules les pétitions reçues à la présidence de l’Assemblée nationale sont transmises à la commission des lois. Sur les conclusions du rapporteur, la commission des lois peut prendre trois types de décisions : le classement pur et simple de la pétition ; le renvoi de celle-ci à une autre commission permanente, à un ministre ou au médiateur de la République ; la soumission de la pétition à l’Assemblée. La seconde, auprès du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a été instaurée par la loi organique de juin 2010. Pour être valide, la pétition doit être signée par au moins 500.000 personnes de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Son objet doit porter sur une question d’intérêt général, à caractère économique, social ou environnemental. En vertu de l’article 69, alinéa 3 de la constitution, le CESE, après examen de la pétition, « fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner ». C’est donc au CESE à relayer la proposition, qui sera éventuellement reprise ou non par l’Assemblée nationale ou le pouvoir exécutif. En somme : de nombreux filtrages et des délais excessivements longs qui en font des procédures lourdes.
[13] « La participation citoyenne doit en effet constituer un outil démocratique pour mettre à l’agenda politique des questions qui touchent les Français. Elle ne doit pas apparaître comme un mode de déstabilisation des institutions représentatives ou un moyen d’en contester constamment les décisions. C’est la raison pour laquelle il est prévu que la proposition de texte de loi soumise à cette procédure ne peut avoir ni pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins de trois ans (et non un an comme aujourd’hui), ni porter sur le même objet qu’une disposition introduite au cours de la législature et en cours d’examen au Parlement ou définitivement adoptée par ce dernier et non encore promulguée », Présentation du projet de loi constitutionnelle « Pour un renouveau de la vie démocratique », 29 août 2019.
[14] VIKTOROVITCH, C., Conclusion « Le Parlement, les citoyens et la délibération » in « Le Parlement et les citoyens », Les cahiers du CEVIPOF, Olivier Rozenberg et Clément Viktorovitch (dir), Octobre 2014, n°58.
[15] Cela renvoie à la vision de DUPUIS DÉRI, F., le vote en tant « qu’expropriation du peuple de son pouvoir ».
Comment l’État doit se réverbérer pour permettre au corps social de ne pas s’effondrer
Dans la préface de 1963 de son ouvrage La notion de politique, Carl Schmitt déclarait de façon pour le moins inattendue que « l’ère de l’État [était] à son déclin ». Du point de vue de la France gaullienne et planificatrice, la formule avait de quoi sembler saugrenue. Trente ans plus tard, le juriste Olivier Beaud dans sa thèse de référence sur la Puissance de l’État (1994) soulignait pourtant ex post la justesse du constat. Il fallait se rendre à l’évidence : la question de la « péremption » de l’État était désormais d’actualité. De toutes parts, des voix se bousculaient pour réclamer sa fin et son dépassement. L’État était accusé à la fois d’être « trop » et « pas assez » : trop pour ceux qui défendaient le localisme, le régionalisme ou le communalisme ; pas assez pour ceux qui prophétisaient une nouvelle ère géopolitique globalisée où n’existeraient que des superpuissances.
Cette période vient de subir un coup d’arrêt. La crise du Covid19, agissant comme un mouvement de balancier, a renvoyé le pendule de l’histoire dans les mains des partisans de l’État. Tous les médias s’en font l’écho : Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix, Le 1 hebdo etc. Nous assistons, titrent ces journaux, au « grand retour de l’État ». Comment l’expliquer ? L’argumentation en sa faveur relève d’abord de la psychologie collective. Pour le dire à gros traits, le monde entier vient d’être heurté par une gigantesque vague de panique provoquée par la propagation incontrôlée du virus. Les populations, déboussolées et à la merci d’informations contradictoires et désordonnées, se sentent sans défense, démunies, vulnérables. Dans un pays comme la France à la culture étatique ancienne, demander le retour de l’État correspond à une forme « d’appel à l’aide » quasi-primaire. Car en dépit des réactions épidermiques qu’il suscite dans l’hexagone, l’État est en même temps perçu comme une figure tutélaire forte et protectrice à même de nous sauver. Mais l’argumentation possède aussi un volet que l’on pourrait qualifier « d’opportunité ». Elle appuie sur l’effet de « dévoilement » de la crise du Covid19 et sur sa mise à nue de tous les dysfonctionnements de notre monde : zoonoses causées par la destruction de la biosphère, vicissitudes sanitaires, flux incontrôlés, marché du médicament soumis à des chaînes de valeur démembrées, système social en tension, services publics saccagés, classes populaires surexposées … Dans ce jeu de massacre, les gouvernements européens, à commencer par le gouvernement français, ont semblé impuissants et incapables d’être à la hauteur, renforçant par-là même le besoin d’État. Ainsi a resurgi une discussion sur « la place de l’État » dans l’espace politique que beaucoup croyait close et il y a fort à parier qu’elle sera au cœur de la confrontation des Weltanschauung du « monde d’après ».
Pour autant, se contenter d’acter de façon passive le retour de l’État constituerait une erreur au regard des enjeux de l’époque qui intiment d’agir. Il convient dans cette perspective de se saisir de cette « réapparition » de la figure de l’État pour questionner sa signification française (sa formation, sa spécificité) (I) et expliquer pourquoi et comment a eu lieu sa fin programmée (II). Ce n’est qu’en analysant la tension entre son affirmation et sa négation que l’on pourra aboutir à une proposition renouvelée de la praxis étatique à la hauteur de l’évènement (III).
Table des matières
I/ L’Etat à la française
II/ Démembrement et fin programmée de l’Etat : l’histoire d’une défiance
III/ Construire l’État nouveau
I/ L’État à la française
Par une curieuse légende dont on ne saurait dire l’origine exacte, on se plaît à attribuer à
Louis XIV un mot impérieux : « L’État, c’est moi ». Pourtant la citation est apocryphe. Mieux, on connaît avec certitude les dernières paroles du « roi soleil » sur son lit de mort et elles dédisent la légende : « Je m’en vais mais l’État, lui, demeurera toujours ». Louis XIV ne s’est pas trompé. Né autour du XVe siècle, l’Etat, création de l’ordre monarchique, est passé à la République par l’intermédiaire de la Révolution et de l’Empire. Ce legs, depuis, pose question. L’État républicain, en vertu de cette filiation, ne serait-il qu’une version abâtardie de l’État monarchique ? Comment expliquer que notre ère révolutionnaire dont on sait qu’elle s’est ouverte sur une politique de table rase, ait pu garder un tel vestige de l’Ancien Régime ? L’étymologie nous fournit un premier indice. « État » vient du latin « status » lui-même provenant de « stare » qui signifie « se tenir ». Quelques fois, on traduit également cette étymologie par l’idée de « perdurer ». Et c’est bien de cela dont il est question à l’origine, de cette question qui obsède tout titulaire du pouvoir depuis l’Antiquité : comment demeurer et se perpétuer ? La monarchie française n’échappe pas à cette obsession. Frappée par différentes crises de succession au cours des siècles, elle n’a de cesse de chercher les moyens de sa stabilité et de sa permanence. Entre le XIVe et le XVIIe siècle, la monarchie française élabore ainsi un corpus de règles qui s’imposent au monarque lui-même et à toute sa famille : ce sont les lois fondamentales du royaume. Il convient qu’en dépit des aléas de la vie humaine des rois et de leurs lots de tragédies un continuum politique existe. Ernst Kantorowicz a montré que les juristes anglais inventeront pour cette raison la théorie des « Deux corps du roi » : si l’un est physique, soumis au temps et mortel ; l’autre est mystique, a-temporel et immortel. En France, ce continuum sera formulé par différents adages (« le roi ne meurt pas en France », « le roi est mort, vive le roi »). Mais les guerres de religion (XVIe siècle) ajoutent à l’antique obsession une angoisse nouvelle : celle de la fragmentation sociale. Pendant deux siècles, juristes (Bodin, Loyseau, Cardin Le Bret), hommes d’autorité (Richelieu, Mazarin), hommes d’Église (Bossuet) et grands commis du royaume (Colbert, Louvois) s’efforcent en conséquence de donner à la monarchie une cimentation empêchant cette fragmentation : c’est l’État. Et c’est d’abord cet aspect-là que les révolutionnaires voudront garder en reprenant la machine étatique, ce ciment qui permet au pays de se maintenir debout malgré les circonstances. L’idée parcourt tout le discours jacobin de 1792-1794 : il faut tenir contre les monarchies coalisées à l’extérieur, tenir alors que tout menace de ruine à l’intérieur, tenir parce qu’il y a « une République à fonder » (Saint-Just). L’événement révolutionnaire livre à cet instant la singularité du rapport que le républicanisme des origines entretient alors à l’État. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, il n’existe pas de culte de l’État dans ce premier républicanisme à la française. La « foi », s’il y a foi, est tournée vers la Révolution, la liberté, la République, les martyrs, non vers l’État. Symbole de cette erreur historique, on utilise souvent le terme de jacobinisme pour parler d’étatisme. Mais le jacobinisme originel, c’est avant tout 1. La passion de l’égalité, 2. La croyance dans la souveraineté populaire, 3. Le culte de la loi, conçue comme expression de la volonté générale, 4. Le souci des « malheureux ». Dans cette perspective, ce n’est pas la Révolution ou la République qui est au service de l’État mais l’inverse. La République jacobine se sert de l’État pour mener à bien son programme. C’est grâce à la puissance de l’État que l’on peut s’assurer que la loi est la même partout et pour tous sur le territoire, grâce à lui que les justiciables peuvent ne plus souffrir de l’arbitraire des Parlements locaux, grâce à lui qu’une « sécurité sociale » peut commencer à secourir les plus démunis jusque dans les coins les plus reculés du pays.
La IIIe République reprend ce flambeau au prix d’une certaine mue intellectuelle. La Révolution, on vient de le voir, avait envisagé l’État comme partie intégrante de son processus et de ce fait, n’avait point cherché à exalter une « culture de l’État » propre. Mais la succession de régimes au XIXe siècle (L’Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, le Second Empire) modifie la donne. Dans chacun de ces régimes, les républicains observent une dimension qui fait défaut à la République institutionnelle : son administration au long court. Depuis 1792, on est mort pour la République, on s’est sacrifié pour elle, mais on n’a pas eu le temps de la servir comme on a servi l’empereur ou le roi. La IIIe République s’efforce de changer cet état de fait. De là l’édification d’une véritable « fonction publique ». « Servir l’État » devient alors un honneur. Probablement parce qu’au même moment la République met à l’œuvre cet État pour créer et faire vivre les premières grandes lois de liberté, la théorie des services publics (L. Duguit), l’ébauche de la sécurité sociale, un parlementarisme plein et entier.
De cette (trop) brève épure de l’État à la française, il faut ainsi retenir qu’au sein de l’idée républicaine, l’État n’avait pas vocation à dicter l’alphabet politique des choses, il était au contraire envisagé comme un moyen au service de l’œuvre révolutionnaire, un instrument servant à assurer le passage d’un régime monocratique (monarchie, empire) à un régime démocratique. Signalons au passage que ce rôle de levier politique n’est pas universel. De par son histoire, le monde anglo-saxon entretient un rapport radicalement différent à l’État, ce qui explique les régulières critiques qu’il formule contre le modèle français. En Angleterre, la structure sociale trouve sa cimentation dans le respect dévolu à la royauté et à sa longue tradition bien plus qu’au sein de l’État. Aux États-Unis, ce dernier peut même susciter de l’hostilité. Né d’une guerre de libération contre une puissance tentaculaire (l’Angleterre), « l’Amérique », comme le rappelle Tocqueville, tient en défiance toute autorité sociale supérieure. Son modèle puise dans l’idéal petit-propriétaire terrien des Founding Fathers, des premières communautés de colons et de la philosophie lockienne des droits de l’homme. Dans ces deux cas respectifs, l’État est une figure hostile. En France, tout au contraire, l’État, pris d’assaut par les révolutionnaires, a permis l’émancipation collective et l’anéantissement de la société d’ordre et du monde féodal. Pour autant, il y État et État. Et la philosophie républicaine doit servir d’aiguillon pour éviter les confusions entre État monarchique et État républicain. L’élément constitutif d’une République est de gouverner en vue du bien commun. Pour le républicanisme à la française, seul un régime démocratique permet donc d’être en république puisqu’il est le seul régime permettant à ce commun (le peuple) de se gouverner lui-même. Cela signifie se doter de sa propre loi (auto-nomos) et d’être détenteur de la souveraineté. Dans un État monarchique, la souveraineté est aux mains du roi ; dans un État républicain, elle est dans celles du peuple.
II/ Démembrement et fin programmée de l’État : l’histoire d’une défiance
Mais cette possibilité offerte de former un jugement différent sur l’État selon sa forme n’a pas été parfaitement saisie en France. Le procès de l’État s’est souvent fait en bloc et ce dernier a subi une constante remise en cause au cours des XIXe et XXe siècle. Car l’État possède de nombreux adversaires théoriques qui, pour hétéroclites qu’ils sont (libéraux, libertaires, libertariens) se retrouvent dans la dénonciation d’un ethos négatif considéré comme « substantiel ». L’accusation porte généralement sur quatre aspects : 1. Le centralisme ; 2. La démocratie étouffée ; 3. La bureaucratie ; 4. L’économie sous tutelle. Parcourons les raisons de ce consensus accusatoire.
Pour les libéraux, à commencer par ceux du XIXe siècle, l’État est vicié par nature. Qu’importe que cet État soit celui des Bourbons ou de la République démocratique et sociale, il est d’essence liberticide. Face à cette menace, le libéralisme développe toute une doctrine à strates multiples et défend l’individu contre le collectif, la décentralisation contre la centralisation, le local contre le national. Certains – qu’on appelle aujourd’hui libertariens – éprouvent une hostilité telle qu’ils exigent le Droit d’ignorer l’État (1850) comme le revendique le livre d’Herbert Spencer. Le sociologue anglais, à qui on doit aussi le célèbre L’Individu contre l’État (qui influencera les libertariens américains comme Robert Nozick) appelle à un « état minimal » réduit à la seule fonction de sécurité. Toute autre expression étatique est dénoncée comme une intrusion dans la vie privée, une interférence non-supportable. Quelque chose d’assez similaire anime la méfiance d’un camp pourtant opposé en termes d’idéal : l’anarchisme. Chez les anarchistes ou les libertaires se dessinent une conception également négative de l’État accusé d’être en soi répressif, policier, militaire. Dans cette perspective, l’État apparaît comme une instance privative de liberté mais aussi comme le levier servant à la domination des puissants. Accusation que ne nie pas un certain marxisme. Pour Marx, Engels puis Lénine, l’État en Europe a en effet accompagné l’émergence du capitalisme. Capté depuis le XVIIIe siècle par la bourgeoisie, il participe de la structuration de la société en classes et seconde le capitalisme dans « l’exploitation de l’homme par l’homme ». Pour cette raison, Lénine appelle dans l’État et la révolution à briser l’appareil d’État.
Toutefois, pendant longtemps ces doctrines n’ont pas dominé en France, jusqu’à ce qu’un changement se produise autour des années 70. Lors de cette décennie puis lors de la suivante, une véritable tempête s’est abattue sur le concept d’État. Fait notable, cette tempête est survenue par la gauche. Au sein de la jeunesse soixante-huitarde, le « gauchisme » – au sens de Richard Gombin, c’est-à-dire, ce qui se veut « l’alternative radicale au marxisme-léninisme » – dénonce dans l’État la quintessence de la société qu’il rejette : celle de De Gaulle, de l’ORTF, de la censure, de la police, de l’armée, de l’université des mandarins etc. Bientôt, le mouvement écologiste naissant ajoute de nouveaux griefs. L’État symbolise le conflit dans le Larzac, le nucléaire imposé « d’en-haut », la destruction des cultures locales. Au sein du milieu intellectuel, la critique mord également. Le trotskysme étend sa dénonciation du stalinisme comme « état bureaucratique dégénéré » tandis que le groupe « Socialisme ou Barbarie » jouxte cette analyse. Mais le véritable tournant survient au milieu des années 1970 avec l’essor de ce qu’on appellera la « gauche antitotalitaire ». Dans le sillage des écrits de Soljenitsyne mettant devant les yeux du grand public le goulag soviétique, les « nouveaux philosophes » (BHL, A. Glucksmann, Jambet & Lardreau) se livrent à une diatribe en cascade. Le totalitarisme n’est plus seulement sondé dans l’œuvre de l’URSS mais également traqué dans le communisme, le marxisme, puis dans son syncrétisme français jacobino-marxiste et son instrument-bouclier : l’État. Accusé de tous les maux, ce dernier devient l’adversaire des droits de l’Homme, ce qui met en péril la « société » et nie l’individu. Les grandes analyses d’Hannah Arendt sur le totalitarisme sont plaquées sur l’État, ce « monstre froid » qui menace toute sphère privée. Cette charge anti-état prend d’autant plus dans l’opinion publique qu’au même moment des travaux de savants reconnus (Foucauld, Deleuze) mettent aussi en cause l’État et qu’une « deuxième gauche » émergente (Furet, Jacques Julliard, Pierre Rosanvallon, CFDT) travaille à briser le « modèle jacobin », accusé d’être le premier ressort de la matrice totalitaire. Beaucoup de ces textes portent des remarques fondées, justes et précieuses pour penser le politique. Toutefois, il faut dire que le terreau intellectuel labouré par cette offensive va permettre à Michel Rocard ou Jacques Delors d’infuser au sein de la gauche une pensée économique de type social-libérale avec en ligne de mire la nécessité de « réduire le périmètre de l’État ». À partir de ce moment flottera dans l’air une forme de discours dit « de raison » (la fameuse « rationalisation » qui touchera l’administration étatique) selon lequel l’État est trop lourd, trop omnipotent et qu’il doit subir une « cure d’austérité » inspirée du New Public Management. Aujourd’hui différents essais racontent comment le néo-libéralisme s’est implanté en France : par le biais de l’école hayeckienne, du colloque Walter Lippmann, des politiques managériales, des tropismes libéraux de l’UE. Il faut rajouter qu’il put le faire car la résistance historique au libéralisme économique dans l’hexagone avait été jusque-là l’État à la française et qu’à présent, cette résistance n’était plus. C’est ainsi que l’État apparaît aujourd’hui comme un champ de ruine : érodé de l’extérieur par une critique doctrinale multidimensionnelle, il a fini miné de l’intérieur par des décennies de politiques libérales, de droite et de gauche.
III/ Construire l’État nouveau
Le pendule de l’Histoire ressemble aujourd’hui à un boulet de démolition. La séquence historique qui a vu se succéder Gilets jaunes, mouvement des retraites puis crise du Covid19 exhibe de toute part une population meurtrie par ces politiques publiques brutalisantes. La colère qui couve est immense. Les potentialités d’embrasement – qu’elles proviennent de la souffrance des quartiers populaires ou d’un reprise des « actes Gilets jaunes » – sont réelles. Pourtant, penser l’événement historique en u-cronie – i.e. que ce serait-il passé si l’État n’avait pas été si saccagé – n’est probablement pas la voie qu’il faut suivre. Pas plus que celle qui célèbrerait une revanche des étatistes contre les anti-étatistes ou de la « première gauche » contre la « deuxième ». Car on encourrait le risque de retourner à un État lesté de ses pesanteurs passées. Si une pluie de critiques s’est abattue avec tant d’ardeur, c’est qu’il y avait à dire. L’État nouveau doit s’appuyer sur ces critiques, travailler à se défaire de sa caricature, accepter d’être défétichisé s’il faut. Dans le même temps, deux chantiers intellectuels doivent être ouverts pour répondre à deux des affirmations anti-étatistes que nous avons vu exposées ci-dessus : 1/L’État est l’ennemi de la société ; 2/L’État est l’ennemi de la liberté. Ces chantiers sont d’autant plus prioritaires que ces affirmations rencontrent de plus en plus d’échos. Pour une grande partie de la population, notamment au sein des classes populaires, l’État n’apparaît en effet que sous sa forme négative : que ce soit à raison de sa dimension fiscale (taxes, « charges », radars autoroutiers) ou répressive (violences policières, contrôle au faciès, restrictions des libertés). Cette multiplicité d’éléments que l’opinion publique ne relie pas aux redistributions sociales alimente l’image d’un État coupé de sa population ou, pire, érigé contre elle et sa liberté. Cet état de fait exige en réponse l’amorce d’un double processus :
1/ D’une part, il faut reconnecter l’État à la société. La dimension permanente et continue de l’existence étatique étant le renversé/le miroir inversé de la vie humaine (soumise à la mort et l’extinction), on a pris l’habitude de concevoir l’État comme appartenant à une sphère séparée de celles des Hommes. À tort. En s’appuyant sur la philosophie politique de Spinoza, il est possible de penser l’État, non comme une instance subsistant en dehors des Hommes mais comme une véritable émanation de ces derniers. Pour Spinoza, ce qui définit toute chose c’est le conatus – c’est-à-dire « l’effort » par lequel cette chose « tend à persévérer dans son être » (L’Éthique). Ce conatus chez l’Homme lui confère à la fois un besoin de liberté et de sécurité. Depuis Hobbes, on sait que l’État formé par contrat social est généralement perçu comme le meilleur garant de la sécurité individuelle. Mais cette sécurité se paye au prix de la liberté. Le coup de force de Spinoza est de trouver le moyen d’allier les deux. Pour y parvenir, écrit le philosophe hollandais, il convient de mettre en place un État démocratique. Mu et régi par le demos, l’État protège et sert nécessairement la société qui le commande. De même, n’étant plus une force extérieure à cette société mais son émission, le risque d’une privation de liberté disparaît. Mieux, l’État peut grâce à son imperium augmenter la « puissance d’agir » des individus et développer un « agir social » bénéficiant à tous.
2/D’autre part, il faut (re)faire de l’État, un instrument de combat contre l’ordre injuste. Ici aussi, la mise en œuvre de ce second processus doit puiser dans la philosophie républicaine. Récemment Jean-Fabien Spitz, s’appuyant sur Philip Pettit, a montré en ce sens qu’à rebours d’une certaine vulgate faisant du républicanisme l’ennemi de la liberté, cette dernière est au contraire au cœur de la doctrine républicaine. La controverse provient des différentes acceptions de la notion liberté que Jean-Fabien Spitz modélise entre la « non-interférence » et la « non-domination ». Pour beaucoup, la liberté consiste à « faire tout ce qu’on veut », à ne pas être empêché ni gêné. C’est la liberté revendiquée comme « non-interférence ». Cette conception de la liberté, à l’origine de la pensée libérale et libertaire, rejette l’État catégorisé comme une puissance interférente. Mais il existe une autre conception qui définit la liberté comme une « non-domination ». Cette dernière, héritière du républicanisme antique, considère que la liberté la plus essentielle est celle de ne pas être esclave, en d’autres termes, d’avoir des droits politiques. Aujourd’hui, les partisans de cette liberté républicaine revendiquent de ne pas être blessés dans son humanité, dans sa dignité et de se voir reconnus comme titulaires de droits inaliénables. Aux yeux de cette liberté, conçue comme « non-domination », l’État peut être un adversaire des individus. C’est pourquoi, il doit être encadré et tenu sous le contrôle de pare-feux (le droit, la Constitution, le contrôle administratif d’abus de pouvoir). Mais le danger peut être autre (la guerre, les invasions, la tyrannie). Le désordre du monde actuel doit nous inviter à se saisir de ces deux modèles pour évaluer les dangers contemporains qui mettent en péril les libertés et le corps social. La première de toutes ces menaces est le risque d’effondrement généralisé. Ce risque environnemental met en accusation la vie humaine (l’anthropocène) mais aussi et surtout les conséquences de son activité économique (le capitalocène), comprendre l’extension sans fin du marché, la quête de profit et d’accumulation. En France, écrasés par cette organisation capitaliste de l’économie, les Gilets jaunes ont parlé de leurs « vies diminuées ». À raison. Le phénomène d’aliénation et de fétichisme de la marchandise analysé par Marx continue d’éroder les existences. Les travailleurs, écrasés, souffrent de la domination du monde marchand. C’est ici qu’il faut reconvoquer l’État à la lumière de ces nouvelles données. Connecté démocratiquement aux aspirations du grand nombre, aiguillé par la souveraineté populaire, l’État nouveau devra être missionné pour répondre aux enjeux écologiques, sociaux et démocratiques. Pour ce faire, il faudra s’extirper des débats caricaturaux (centralisation/décentralisation) en proposant un ré-échelonnage de la de la décision publique articulant l’international, le national et le local ; interdire l’aide au financement des chantiers écocides et rediriger ces mannes financières vers la bifurcation écologique, redonner du sens à l’impôt en mettant en place une fiscalité juste et une véritable répression contre l’évasion fiscale ; il faudra enfin rétablir « la République dans les faits » à travers l’activation de nouveaux réseaux, la remise en état des services publics et l’investissement massif dans l’éducation nationale. En un mot, « démocratiser l’État au lieu de le réduire » : telle est la réponse républicaine.
[1] C. Schmitt, La notion de politique ; Théorie du partisan, Paris, Flammarion, 1992.
[2] O. Beaud, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994.
[4] https://www.liberation.fr/debats/2020/03/25/covid-19-le-retour-de-l-etat-providence_1782897
[5] https://www.lefigaro.fr/vox/politique/la-crise-du-coronavirus-ou-le-retour-de-l-etat-20200323
[6] https://www.la-croix.com/Economie/Monde/Face-coronavirus-retour-lEtat-2020-03-261201086163
[7] https://le1hebdo.fr/journal/numero/290
[8] Dans la philosophie allemande, la Weltanschauung correspond à la « conception du monde ».
[9] On doit à Tocqueville la première énonciation de ce continuum étatique, v. A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution (1856), Paris, Gallimard, 1985.
[10] J. Barbey, F. Bluche, S. Rials, Lois fondamentales et succession de France, Paris, Diffusion-Université-Culture, 1984.
[11] E. Kantorowicz, Les deux corps du roi : essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2019.
[12] Il faut également dire que les nombreuses guerres extérieures à partir du XVIIIe siècle vont générer des coûts et la création d’une armée permanente nourrissant ainsi le besoin d’un État percepteur d’impôts désormais vitaux. On peut ainsi dire, comme le résume Charles Tilly dans sa fameuse formule, que « la guerre a fait l’État autant que l’État a fait la guerre ».
[13] Voir sur la nature du « républicanisme jacobin » et sa « sensibilité », J. de Saint-Victor et T. Branthôme, Histoire de la République en France. Des origines à la Ve République, Paris, Economica, 2018, p. 13-17.
[14] M. Braddick, « Réflexions sur l’État en Angleterre (XVIe-XVIIe siècles) », in Histoire, économie & société, 2005, vol. 24e année, no. 1, pp. 29-50.
[15] « L’habitant des Etats-Unis apprend dès sa naissance qu’il faut s‘appuyer sur soi-même pour lutter contre les maux et les embarras de la vie ; il ne jette sur l’autorité sociale qu’un regard défiant et inquiet, et n’en appelle à son pouvoir que quand il ne peut s’en passer », A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835), Paris, Gallimard, 1986, t. II, p. 274.
[16] Des réflexions intéressantes à lire à ce sujet dans le numéro spécial de la revue Nouvelles FondationS, « L’État dans tous ses états », 2007/1, n°5.
[17] Lénine, L’État et la révolution (1917), Paris, La Fabrique, 2012.
[18] Notons qu’il existe en parallèle une tradition contraire qui, de Louis Blanc à Ferdinand Lassalle, considère que l’État peut et doit être utilisé pour lutter contre le capitalisme. Sur la question, P. Fouquet, « Marxisme et socialisme étatique », in Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 12, 1981, n°1. p. 83-119.
[19] R. Gombin, Les origines du gauchisme, Paris, Seuil, 1971.
[20] Sur ce sujet, lire M. S. Christofferson, Les intellectuels contre la gauche : l’idéologie antitotalitaire, 1968-1981, Marseille, Agone, 2014.
[21] P. Clastres, La société contre l’État, Paris, Éditions de Minuit, 1974
[22] Pour une histoire de ce rapport à la « réforme de l’État », voir la thèse de Philippe Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, PUF, 2009.
[23] Pour un regard sur la question, v. N. Matyjasik et M. Guenoun (dir), En finir avec le New Public Management, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2019.
[24] S. Audier, Le colloque Walter Lippmann : aux origines du « néo-libéralisme », Lormont, Le Bord de l’eau, 2012 ; S. Halimi, Le grand bond en arrière : comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, Marseille, Agone, 2012 ; F. Denord, Le néo-libéralisme à la française : histoire d’une idéologie politique, Marseille, Agone, 2016 ; G. Chamayou, La société ingouvernable : une généalogie du libéralisme autoritaire, Paris, La Fabrique, 2018 ; B. Amable et S. Palombarini, L’illusion du bloc bourgeois : alliances sociales et avenir du modèle français, Paris, Raisons d’agir éditions, 2018.
[25] M. Le Bretton, «La révolte au temps du coronavirus» in Quartier général du 23 avril 2020, https://qg.media/2020/04/23/la-revolte-au-temps-du-coronavirus-par-manon-le-bretton/.
[26] Sentiment grandissant actuellement du fait de l’explosion des violences policières. Sur cette question, voir le travail de recension de David Dufresne.
[27] Pour les détails de cette construction philosophique : J. de Saint-Victor et T. Branthôme, Histoire de la République en France. Des origines à la Ve République, op. cit. , p. doit 105-111.
[28] Voir en ce sens l’édito de notre Institut du 23 avril 2020 par Fabien Escalona, https://institut-rousseau.fr/le-retour-de-letat-oui-mais-pas-nimporte-lequel/ .
[29] J.-F. Spitz, Le moment républicain, Paris, Gallimard, 2005.
[30] P. Pettit, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, Paris, Gallimard, 2003.
[31] Cette liberté est donc intimement liée à la notion de citoyenneté. Voir sur toutes ces questions, J. de Saint-Victor et T. Branthôme, Histoire de la République en France. Des origines à la Ve République, op. cit., p. 31-45.
[32] Nicolas Roussellier a ainsi montré que le pouvoir exécutif et l’utilisation des moyens l’État ont été en partie accepté par le grand nombre du fait de l’extension des prérogatives du juge administratif, cf. N. Roussellier, La force de gouverner : le pouvoir exécutif en France, XIXe-XXIe siècles, Paris, Gallimard, 2015.
[33] L’Institut Rousseau propose à ce titre
[34] C’est à un dépassement de ce débat qu’invite la note de Maximilien Pierre-Latour, in https://institut-rousseau.fr/decentralisation-et-organisation-territoriale-vers-un-retour-a-letat/.
[35] Voir en ce sens le livre de David Djaïz, Slow démocratie : comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main, Paris, Allary Editions, 2019.
[36] J.-F. Spitz, Le moment républicain, op. cit.. p. 41.
Pour une couverture totale de l’activité partielle
L’activité partielle constitue un des dispositifs les plus anciens de la politique publique de l’emploi. Il consiste à verser une partie de leur salaire à des employés qui cessent le travail, tout en maintenant leur lien contractuel avec l’employeur…
Lire la suite…
Ce qui doit échapper à la logique de la mondialisation : quelle méthode pour identifier les secteurs stratégiques de l’économie ?
Depuis l’éclatement de la crise sanitaire, l’idée que la France doit s’émanciper de chaînes de valeur mondialisées pour son approvisionnement en biens vitaux fait brusquement consensus. La pénurie criante de masques de protection qui a obéré la réponse française à l’épidémie s’est accompagnée d’autres fragilités dans le domaine des respirateurs ou encore des médicaments…
Lire la suite…
Vers un « Nouvel ordre écologique international »
Nous disposons d’une longue histoire de négociations et de propositions qui ont taché d’imposer une autre forme de gouvernance économique internationale. Le projet de « Nouvel ordre économique international » porté dans les années 1960-1970 par les pays du Sud, avec l’appui de la CNUCED, cherchait par exemple à réguler les flux commerciaux, encadrer les entreprises multinationales,
<a href="https://www…
Lire la suite…
Sortir vite et durablement de la crise économique en utilisant la création monétaire et l’annulation de dettes
Lorsqu’il s’agit de la réponse monétaire et budgétaire à la crise du Coronavirus, on a le choix dans la démesure des chiffres, mais gare aux mirages qui sont nombreux. Aligner des zéros peut s’avérer aussi trompeur que de les perdre…
Lire la suite…
Droits de Tirage Spéciaux, Covid-19 et environnement : The time is now, the question is how ?
Comme dans bon nombre d’autres domaines, la pandémie de Covid-19 a agi comme un révélateur des fragilités préexistantes du système monétaire et financier international (SMI). Depuis les années 1980, le cycle financier, guidé par les grandes institutions financières internationales, a déterminé les dynamiques économiques du régime de croissance financiarisé [1]…
Lire la suite…
Notre système de santé après le covid-19 : réussir le changement de paradigme
Depuis le début de l’épidémie de covid-19, le Président de la République s’est engagé à plusieurs reprises à un effort massif en faveur de l’hôpital public et des soignants. Le directeur général de l’ARS Grand Est a été limogé pour avoir affirmé que la restructuration du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy se poursuivrait
<a href="https://www…
Lire la suite…
Comment reconstruire ?
L’Institut Rousseau a été fondé le 4 mars 2020 lors d’une soirée qui a réuni quelque 500 personnes. Une semaine plus tard, cet événement aurait été impossible. En ce mois de mars 2020, la vie sociale s’est soudainement arrêtée, la peur est apparue et certains des dogmes qui régissaient notre vie économique et sociale se
<a href="https://www…
Lire la suite…


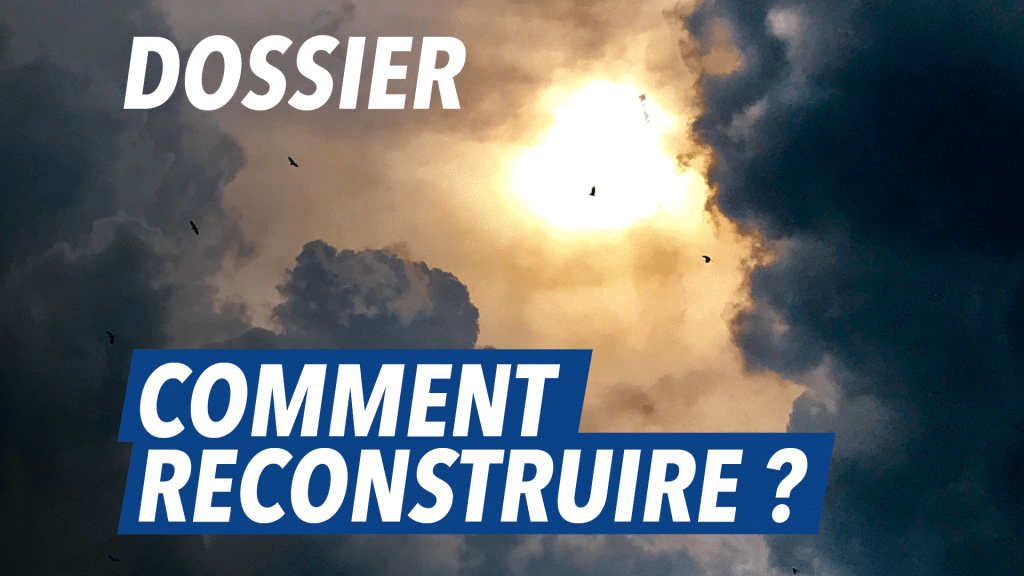














L’urgence d’une indépendance numérique révélée par l’urgence sanitaire
Dans la gestion de la crise actuelle, la place accordée aux technologies du numérique a été au cœur de nombreux débats. En particulier, la question de l’accès aux données personnelles est devenue centrale dans les échanges autour du traçage des contacts et du partage des données de santé…
Lire la suite…