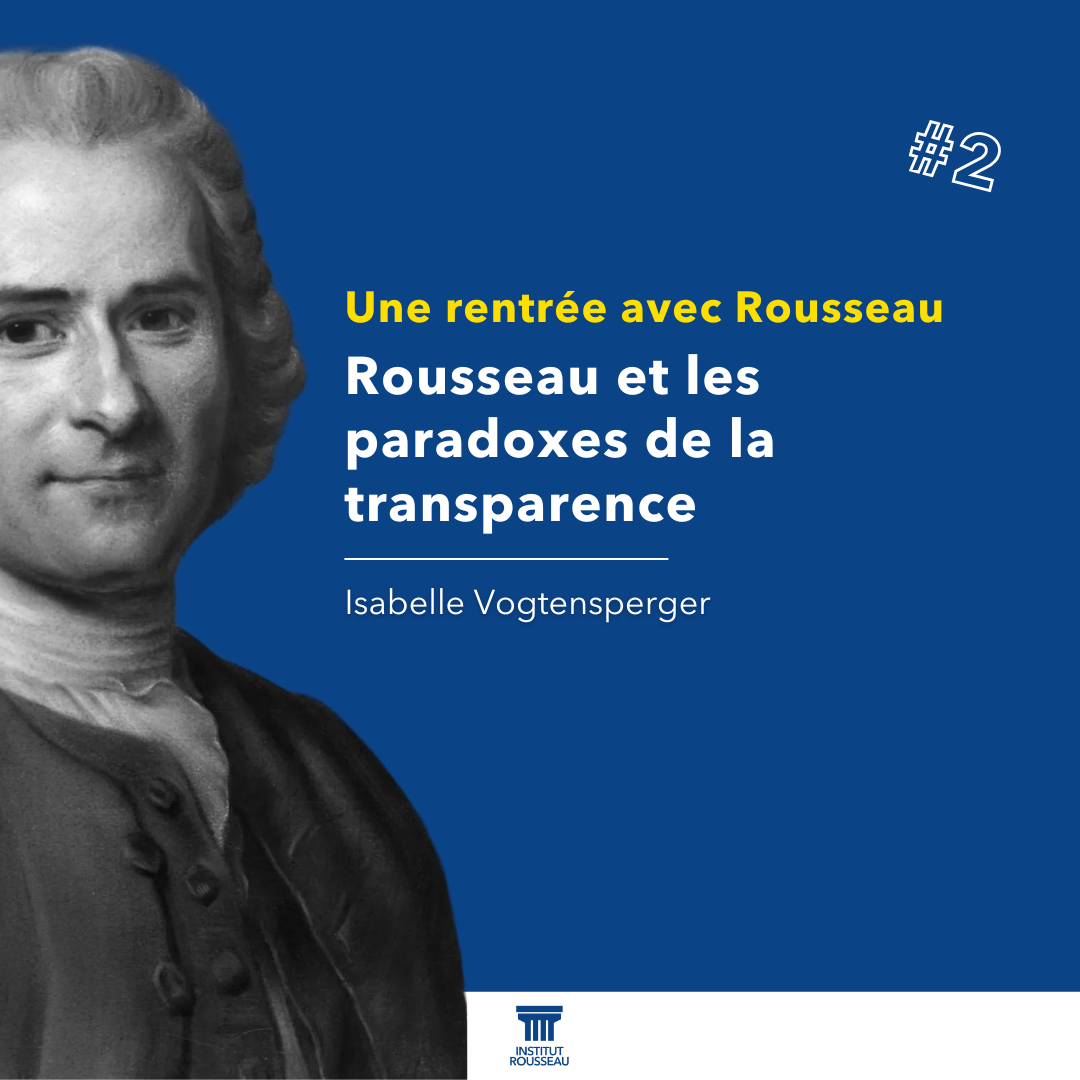On n’ose plus paraître ce qu’on est ; et dans cette contrainte perpétuelle, les hommes qui forment ce troupeau qu’on appelle société, placés dans les mêmes circonstances, feront tous les mêmes choses si des motifs plus puissants ne les en détournent. On ne saura donc jamais bien à qui l’on a affaire.
En 1749, le philosophe révèle déjà, dans son Discours sur les sciences et les arts, l’emprise de l’apparence sur les rapports humains et l’impossibilité d’une communication authentique. Cette analyse soulève une question fondamentale : la transparence – cette capacité à être perçu tel que l’on est – peut-elle remédier à ce travestissement généralisé des relations sociales ? Cette interrogation trouve un écho singulier dans nos sociétés contemporaines où la transparence est érigée en vertu cardinale, devenue une norme morale, politique et sociale. Elle cristallise les aspirations contemporaines à la vérité, à l’intégrité et à la démocratisation de l’information. Dans cette logique, la visibilité devient synonyme de légitimité et de vertu morale. D’où une injonction paradoxale : il faudrait sans cesse se montrer, s’exhiber pour attester de sa bonne foi, comme si l’authenticité ne pouvait s’affirmer qu’à travers l’exposition permanente de soi. Pourtant, cette surenchère dans la démonstration de sincérité produit l’effet inverse : elle suscite la suspicion qu’elle prétend dissiper. C’est un paradoxe que Jean Starobinski analyse dans son essai Jean-Jacques Rousseau. La transparence et l’obstacle (1971) : en voulant incarner la transparence, Rousseau s’enlise dans une théâtralisation de la sincérité qui, loin de garantir son authenticité, en expose les contradictions et la vulnérabilité inhérentes.
La transparence des cœurs : un paradis perdu
Chez Rousseau, la transparence renvoie à un état originel, antérieur au langage social, où les relations humaines étaient immédiates et exemptes d’artifice. Dans cet état de nature, que Rousseau reconstitue, les individus vivaient simplement, guidés par leurs besoins essentiels, sans rivalité ni tromperie. Aucun écran ne s’interposait entre les âmes : l’expression du cœur coïncidait avec l’action, dans une forme d’accord spontané : « La nature humaine, au fond, n’était pas meilleure ; mais les hommes trouvaient leur sécurité dans la facilité à se pénétrer réciproquement » écrit Rousseau (Discours sur les sciences et les arts). Les fêtes décrites dans sa Lettre à d’Alembert (1758) sont comme une résurgence de cet état : elles incarnent une communication directe et sans masque. Mais cette harmonie primitive s’est perdue.
Dans le Discours sur les sciences et les arts, Rousseau montre comment la civilisation, en raffinant les mœurs et en embellissant les relations sociales, a instauré le règne du paraître. Ce progrès apparent masque une profonde corruption : les hommes, écrit-il, « étendent des guirlandes de fleurs sur des chaînes de fer dont ils sont chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblaient être nés, leur font aimer leur esclavage, et en forment ce qu’on appelle des peuples policés ». Les arts et les savoirs, en civilisant, dissimulent les rapports de domination, la rivalité et l’hypocrisie qu’ils entretiennent. Le lien social devient alors jeu, flatterie, et compétition. Cette bascule s’illustre dans un épisode marquant des Confessions : l’affaire des peignes de Mademoiselle Lambercier. « Quand elle revint les prendre, il s’en trouva un dont tout un côté de dents était brisé. À qui s’en prendre de ce dégât ? Personne autre que moi n’était entré dans la chambre ». Accusé à tort, le jeune Jean-Jacques découvre que la vérité ne suffit pas face à l’apparence de culpabilité. Le regard d’autrui, loin de révéler, opacifie : il empêche l’expression authentique du soi. À partir de cette expérience fondatrice, la sincérité devient problématique, voire impossible. Comme le souligne Starobinski, le regard social introduit ainsi une séparation radicale entre l’être et le paraître, entre le cœur et son expression – générant ce qu’il nomme une « déchirure ontologique ».
Le mensonge social : théâtre du monde
À l’image du théâtre que Rousseau critique dans sa Lettre à d’Alembert, la mise au grand jour, la visibilité moderne obéissent à une logique d’exposition. Il ne suffit plus d’être sincère : il faut le prouver en se montrant : « Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même » (Discours sur l’origine de l’inégalité). Mais ce que l’on donne à voir n’est plus l’être authentique. L’apparence prend le pas sur l’essence. Que ce soit sur la scène politique ou dans les interactions sociales, chacun est contraint de montrer sa probité et de jouer son rôle. L’industrie capitaliste, le développement des réseaux sociaux ne font qu’accroître cette interdépendance fondée sur la facticité. Chacun ne pouvant réussir et trouver une visibilité médiatique qu’en faisant sa propre promotion, qu’en flattant et se liant à ses semblables de façon opportune : « Il faut donc qu’il cherche sans cesse à les intéresser à son sort, et à leur faire trouver en effet ou en apparence leur profit à travailler pour le sien : ce qui le rend fourbe et artificieux avec les uns et dur avec les autres ». On entre alors dans une mécanique de justification permanente, où chaque parole est interprétée comme stratégie narcissique, chaque geste, comme calcul. Comme dans un spectacle, tout le monde regarde, juge et interprète. Ainsi, loin de faire disparaître les masques, l’injonction à la transparence ne fait que les multiplier.
La quête de transparence : entre retrait et exhibition
Afin de contrer cette tendance et de se soustraire à la dissimulation, Rousseau se donne pour ambition, dans les Confessions, de montrer « un homme dans toute la vérité de la nature » – entreprise inédite de transparence absolue. Pourtant, cette quête dévoile d’emblée sa propre limite. Car une transparence sans regard extérieur, sans témoin, perd sa raison d’être. D’où le paradoxe central : pour retrouver l’authenticité perdue, Rousseau doit s’exposer, exhiber son intériorité et affirmer publiquement son refus des masques sociaux. Il proclame son rejet de la comédie sociale, son retrait de la vie mondaine – symbolisé par son départ pour l’Hermitage – à travers une mise en scène de ce rejet. Il dénonce le langage comme vecteur de dissimulation, tout en en faisant l’instrument de sa quête de vérité. Il condamne le regard d’autrui tout en s’y livrant. Rousseau veut atteindre l’universel au prix d’une coupure avec la société – qu’il continue pourtant d’interpeller. Pris dans cette tension, il devient l’otage de son propre exhibitionnisme. Il s’érige en témoin, revendiquant un lien singulier à la vérité, mais ce rôle le contraint à sans cesse prouver sa sincérité, à attendre – tel un martyr – la validation de son message.
Cette quête de la lumière, de la visibilité qu’il poursuit est donc tout sauf immédiate : elle est médiatisée, théâtralisée. Sa sincérité, exhibée, devient suspecte – et ce décalage le voue au malentendu et à l’incompréhension. Accusé de misanthropie, de dureté, Rousseau se voit condamné là où il cherche à aimer et à comprendre ses semblables. Ce paradoxe trouve un écho dans nos démocraties. Les instruments de transparence se multiplient – déclarations, contrôles, publications – mais loin de dissiper la défiance, semblent la nourrir. En rendant visible ce qui restait autrefois dissimulé, ils alimentent une logique de soupçon. Le citoyen devient voyeur, le politique comédien. La transparence devient spectacle, et l’authenticité, une performance.
L’impossible coïncidence : une transparence tragique
Au cœur de sa quête de transparence, Rousseau fait une découverte essentielle : il ne coïncide pas avec lui-même. Dans le Livre IX des Confessions, il reconnaît l’instabilité de son être, sa mobilité intérieure, ses contradictions : « Qu’on cherche l’état du monde le plus contraire à mon naturel, on trouvera celui-là. Qu’on se rappelle un de ces courts moments de ma vie où je devenais un autre, et cessais d’être moi ; on le trouve encore dans le temps dont je parle ». Le rêve d’un moi stable, pur, naturel, se dissout dans le constat d’une subjectivité mouvante et fragmentée. Dès lors, l’écriture de soi ne peut plus être révélatrice d’une essence unifiée : elle fabrique le moi autant qu’elle le dévoile – et parfois même, le trahit. La transparence prend alors une dimension tragique. Elle n’est pas le retour apaisé à un état premier, mais l’expression d’une tension irréductible entre l’idéal d’authenticité et l’expérience de la division intérieure. Rousseau aspire à une langue antérieure au langage social, une langue directe, affective, qui dirait l’émotion sans détour : tout dire, tout confesser, se montrer sans fard. Cette ambition relève d’une construction, comme le souligne Starobinski. L’acte d’écriture devient un théâtre de la sincérité, où se mêlent dévoilement et dissimulation. Ainsi, Rousseau écrit autant pour se cacher que pour se montrer. Il fuit la société, mais ne cesse de solliciter son regard. Cette dialectique entre retrait et appel, entre solitude et exposition, scelle l’ambiguïté de sa démarche : la transparence devient une forme de mise en scène du vrai, toujours menacée par son propre artifice.
Conclusion
Le paradoxe rousseauiste rejoint nos propres contradictions contemporaines. Aujourd’hui, la transparence est partout revendiquée : par les institutions, les politiques, les entreprises, les individus. Mais celle-ci, souvent réduite à de la visibilité (voire du voyeurisme) engendre elle aussi du soupçon, du contrôle, de l’inquisition, de l’artificialité. Les dispositifs de surveillance, de mise en scène de soi, de justification permanente reproduisent cette tension décrite par Rousseau : la transparence devient écran, exhibition, performance – loin de la sincérité qu’elle prétend restaurer. L’injonction contemporaine au « tout dire, tout montrer », malgré son côté positif, séduisant et vertueux, s’avère contre-productive. Elle éveille les convoitises, nourrit les suspicions, transforme la vertu en vice apparent. Alceste, dans Le Misanthrope, en fait l’amère expérience : la sincérité absolue demeure inconciliable avec la vie sociale. Face à cet exhibitionnisme contemporain, la sagesse ovidio-cartésienne garde sa pertinence : Et bene qui latuit bene vixit (qu’on reprend souvent par la formule : « Vivre caché, c’est vivre heureux »). Non par lâcheté, mais par lucidité sur les limites de la transparence comme idéal social. La véritable sincérité ne réside peut-être pas dans l’exposition, mais dans la retenue choisie.