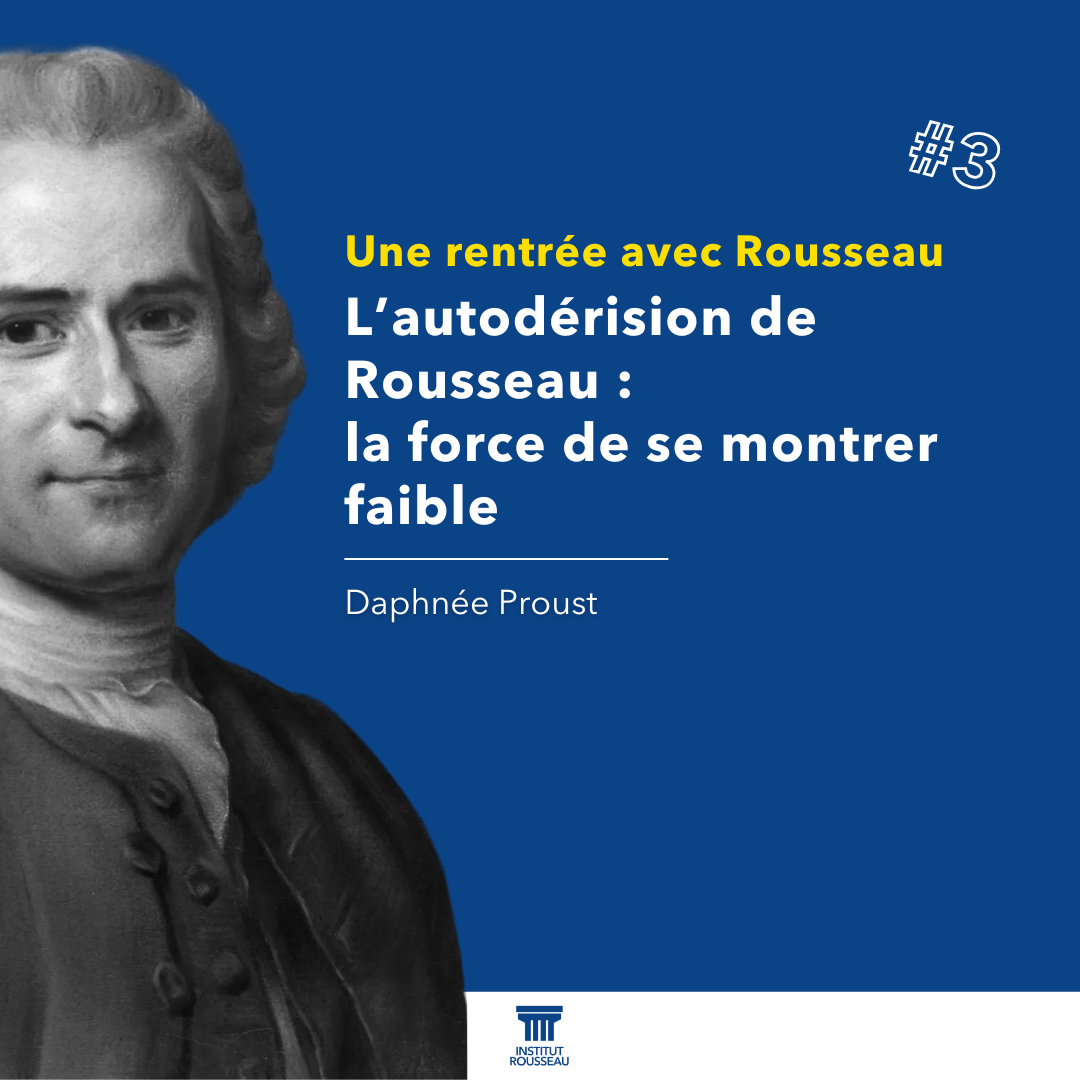Dans le milieu intellectuel du XVIIIème siècle – et peut-être encore dans celui d’aujourd’hui – railler Jean-Jacques Rousseau est un plaisir accessible. Il faut avouer que les vues originales et les actes atypiques de ce philosophe orgueilleux l’exposent au sarcasme. En effet, abandonner ses enfants ne l’a guère empêché de produire un traité d’éducation de près de mille pages. De constitution souffreteuse, il préconise une vie de labeur, modeste et rurale, qu’il n’épouse pas lui-même. Autodidacte, pourfendeur des arts et des sciences, il ne s’interdit pas de multiplier les œuvres littéraires et autres traités philosophiques. Se piquant tantôt de théorie musicale, il compose un opéra à ses heures perdues. Tantôt, ce sont la botanique ou la géométrie qui essaiment leurs concepts en ses œuvres prolixes.
En 1755, Voltaire écrit à Rousseau ce que lui inspire la lecture du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes : « On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre Bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. »[1]
Dans une lettre parue en 1766 et adressée au « Docteur Pansophe », un sobriquet derrière lequel on reconnaît aisément Rousseau, on lit : « Judicieux admirateur de la bêtise et de la brutalité des sauvages, vous avez crié contre les sciences, et cultivé les sciences. Vous avez traité les auteurs et les philosophes de charlatans ; et, pour prouver d’exemple, vous avez été auteur. […] Pourquoi, ô docteur Pansophe ! dîtes-vous bonnement qu’un État sensé aurait élevé des statues à l’auteur de l’Émile ? C’est que l’auteur de l’Émile est comme un enfant, qui, après avoir soufflé des bulles de savon, ou fait des ronds en crachant dans un puits, se regarde comme un être très important. […] Pourquoi mon ami Jean-Jacques vante-t-il à tout propos sa vertu, son mérite et ses talents ? C’est que l’orgueil de l’homme peut devenir aussi fort que la bosse des chameaux de l’Idumée, ou que la peau des onagres du désert. »[2]
Pour autant, les plaisanteries les plus drôles que l’on puisse lire à son encontre ont certainement été écrites par Rousseau lui-même. Il est vrai que le projet des Confessions, tel qu’il est exposé dès les premières lignes, présuppose de l’auteur qu’il admette et décrive ses fragilités et ses travers. Il s’engage en effet à présenter « un homme dans toute la vérité de la nature »[3] : Jean-Jacques Rousseau lui-même. Or, lorsque cette vérité n’est pas à l’avantage du philosophe, ce dernier choisit souvent de l’énoncer de façon comique. Cette autodérision caractéristique, ce dévoilement opportun de certaines faiblesses qu’un autre eût tenté de dissimuler, est sans doute une grande force de l’œuvre de Rousseau, révélant ses qualités, désarmant ses détracteurs.
Ainsi décrit-il maintes fois l’esprit lent, l’absence de répartie, qui expliquent son manque d’aisance en société et la réputation peu favorable qu’il s’y forge :
« Deux choses presque inalliables s’unissent en moi sans que j’en puisse concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions vives, impétueuses, et des idées lentes à naître, embarrassées et qui ne se présentent jamais qu’après coup. On dirait que mon cœur et mon esprit n’appartiennent pas au même individu. Le sentiment plus prompt que l’éclair, vient remplir mon âme, mais au lieu de m’éclairer, il me brûle et m’éblouit. Je sens tout et je ne vois rien. Je suis emporté mais stupide ; il faut que je sois de sang-froid pour penser ».[4]
La dissymétrie entre une forte propension à sentir et s’émouvoir, et une faible aptitude à raisonner sur le vif, produit l’image comique d’un être gauche et malhabile, destiné à commettre nombre de balourdises :
« Ce qu’il y a de plus fatal est qu’au lieu de savoir me taire quand je n’ai rien à dire, c’est alors que pour payer plus-tôt ma dette, j’ai la fureur de vouloir parler. Je me hâte de balbutier promptement des paroles sans idées, trop heureux quand elles ne signifient rien du tout. En voulant vaincre ou cacher mon ineptie, je manque rarement de la montrer ». [5]
Sans doute Rousseau désamorce-t-il, en les produisant lui-même, les railleries qu’on pourrait lui adresser : l’autodérision, par l’effet de surprise qu’elle suscite, peut l’emporter en comique sur la simple moquerie. Elle fournit aussi la preuve d’une distance critique vis-à-vis de lui-même, que l’auteur partage avec ses détracteurs. Mais en même temps il se démarque de ces derniers, en éclairant la cause du défaut signalé : en l’occurrence, une incapacité à réfléchir suffisamment vite. En outre, non content d’attendrir un lecteur qui peut s’identifier, lorsqu’il est maladroit, à l’auteur des Confessions, cet aveu dédouane Rousseau des propos offensants qu’il a proférés malgré lui – et dont il restitue d’ailleurs un certain nombre. Car c’est précisément la vaine tentative de se conformer à l’exigence mondaine d’avoir de l’esprit qui lui a valu la mauvaise réputation dont il souffre. Cette humaine imperfection, cette bonne volonté contrariée, dissuadent de condamner Rousseau pour sa maladresse – d’autant plus qu’il l’admet volontiers.
Par ailleurs, ces aveux rendent crédibles les confessions de l’auteur. Puisqu’il énonce spontanément ses défauts avec une telle lucidité, comment le soupçonner de n’être pas bon juge de ses propres qualités ? C’est ainsi que Rousseau peut ajouter, après s’être moqué de lui-même :
« Ce qu’il y a d’étonnant est que j’ai cependant le tact assez sûr, de la pénétration, de la finesse même pourvu qu’on m’attende : je fais d’excellents impromptus à loisir ; mais sur le temps je n’ai jamais rien fait ni dit qui vaille. Je ferais une fort jolie conversation par la poste, comme on dit que les Espagnols jouent aux échecs ».[6]
Ce contraste entre une fine intelligence qui se manifeste lorsqu’elle n’est pas exigée, et une complète indigence lorsqu’il faut faire preuve d’un peu de répartie, n’est pas seulement comique : il est vraisemblable. L’être que décrit Rousseau, parce qu’il est contradictoire et défaillant, paraît d’autant plus vivant.
Or, l’autodérision permet non seulement de souligner ces paradoxes qui révèlent l’humanité de l’auteur, mais aussi d’en constituer un nouveau : car par le geste de se présenter sous un jour défavorable, elle contribue à le rendre appréciable. Il s’opère, par l’autodérision, une forme de dissociation entre un sujet qui raconte et un soi raconté, le premier tirant gloire du ridicule du second. Ainsi Rousseau dresse-t-il un portrait du jeune Jean-Jacques, incorrigible rêveur qui, se rendant à pied à Paris pour y occuper un poste subalterne auprès du neveu d’un colonel des Gardes suisses, s’invente une brillante carrière militaire et se trouve déjà las d’être maréchal avant même de s’être engagé :
« Je croyais déjà me voir en habit d’officier avec un beau plumet blanc. Mon cœur s’enflait à cette noble idée. J’avais quelque teinture de géométrie et de fortifications ; j’avais un oncle ingénieur ; j’étais en quelque sorte enfant de la balle. Ma vue courte offrait un peu d’obstacle, mais qui ne m’embarrassait pas, et je comptais bien à force de sang-froid et d’intrépidité suppléer à ce défaut. J’avais lu que le maréchal Schomberg avait la vue très courte ; pourquoi le maréchal Rousseau ne l’aurait-il pas ? Je m’échauffais tellement sur ces folies, que je ne voyais plus que troupes, remparts, gabions, batteries, et moi au milieu du feu et de la fumée, donnant tranquillement mes ordres la lorgnette à la main. Cependant, quand je passais dans des campagnes agréables, que je voyais des bocages et des ruisseaux ; ce touchant aspect me faisait soupirer de regret ; je sentais au milieu de ma gloire que mon cœur n’était pas fait pour tant de fracas, et bientôt, sans savoir comment, je me retrouvais au milieu de mes chères bergeries, renonçant pour jamais aux travaux de Mars. »[7]
Tournant en dérision l’emphase de sa jeunesse, le narrateur révèle du même coup son humour et une certaine propension à regarder pour ce qu’elle est sa propre fatuité. En même temps qu’il dépeint l’imagination débridée d’un jeune homme inconstant quoique fort ambitieux, il admet en creux le caractère fantasmatique de son désir insatiable de s’élever, de se distinguer.
Ainsi l’autodérision marque-t-elle, chez Rousseau, un curieux mélange d’orgueil et de retenue. Celui qui prétend dans ses Confessions former « une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur »[8], sait également juger certaines de ses ambitions avec circonspection :
« Malheureusement, jetant mes projets du côté de mes goûts, je m’obstinais à chercher follement ma fortune dans la musique, et sentant naître des idées et des chants dans ma tête, je crus qu’aussitôt que je serais en état d’en tirer parti j’allais devenir un homme célèbre, un Orphée moderne, dont les sons devaient attirer tout l’argent du Pérou. »[9]
Peut-être s’agit-il là d’un autre effet de cette tournure d’esprit que Rousseau s’attribue à lui-même, et qui consiste à s’emporter d’abord, pour analyser ensuite : la passion de jeunesse devient, avec le recul, « l’une de ces inconséquences dont [sa] vie est remplie »[10]. Ou peut-être Rousseau, conservant intacte une folle ambition, ne s’en trouve pas moins capable de l’aborder avec humour, sans gravité. Car l’ambivalence qui fonde l’entreprise des Confessions, ne saurait être atteinte sans la révélation d’une forme de laideur, sous peine de mauvaise foi :
« J’avais toujours ri de la fausse naïveté de Montaigne, qui, faisant semblant d’avouer ses défauts, a grand soin de ne s’en donner que d’aimables : tandis que je sentais, moi qui me suis cru toujours et qui me crois encore à tout prendre le meilleur des hommes, qu’il n’y a point d’intérieur humain si pur qu’il puisse être, qui ne recèle quelque vice odieux. »[11]
Si l’un des vices de celui qui se croit le « meilleur des hommes » est l’orgueil, du moins la dérision de ce vice par l’auteur lui-même fournit-elle un gage de probité en même temps qu’un moyen d’en atténuer l’infamie.
En somme, sous la plume de Rousseau, l’autodérision semble servir un intérêt non seulement rhétorique, mais également littéraire et philosophique. D’abord, en anticipant les moqueries dont Rousseau fait souvent l’objet, elle en prévient les effets. Mais elle fonctionne également comme un gage d’authenticité, poussant le lecteur à se fier au narrateur qui admet bien volontiers les plus sordides de ses travers : celui qui se dépeint comme sot et admet son goût pour la fessée[12] ou l’exhibitionnisme[13] ne saurait être soupçonné de dissimuler quelque autre secret honteux. Enfin, cet humour traduit dans la narration-même de Rousseau une propension à l’ambivalence, au paradoxe, que l’on retrouve ailleurs dans sa philosophie ; elle incarne cet être humain dont les vertus occasionnent des défauts. Le narrateur des Confessions, qui sait rire de lui-même, semble ainsi tiraillé entre l’ambitieuse vanité et l’esprit critique ; habile et maladroit ; très sûr de sa science et pourtant, moqueur à son propre endroit. Un être qui, se désarmant, ne cesse jamais de se défendre.
[1] Lettre de Voltaire à Jean-Jacques Rousseau, aux Délices, près de Genève [30 août 1755], dans Voltaire, Correspondance, éd. Théodore Besterman, coll. de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1977, tome IV (1749–1757), p.539.
[2] « Lettre au docteur Pansophe » dans Voltaire, Mélanges, éd. Jacques Van den Heuvel, coll. de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1961, p.831-839.
[3] Les Confessions, éd. Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, t.I, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, Gallimard, 1959, p.5.
[4] Ibid, III, p.113
[5] Ibid, p.115
[6] Ibid, p.113
[7] Ibid, IV, pp.158-159.
[8] Ibid, p.5.
[9] Ibid, V, p.207
[10] Ibid.
[11] Ibid, X, pp.516-517.
[12] Ibid, I, pp.15-16
[13] Ibid, III, pp.88-90.