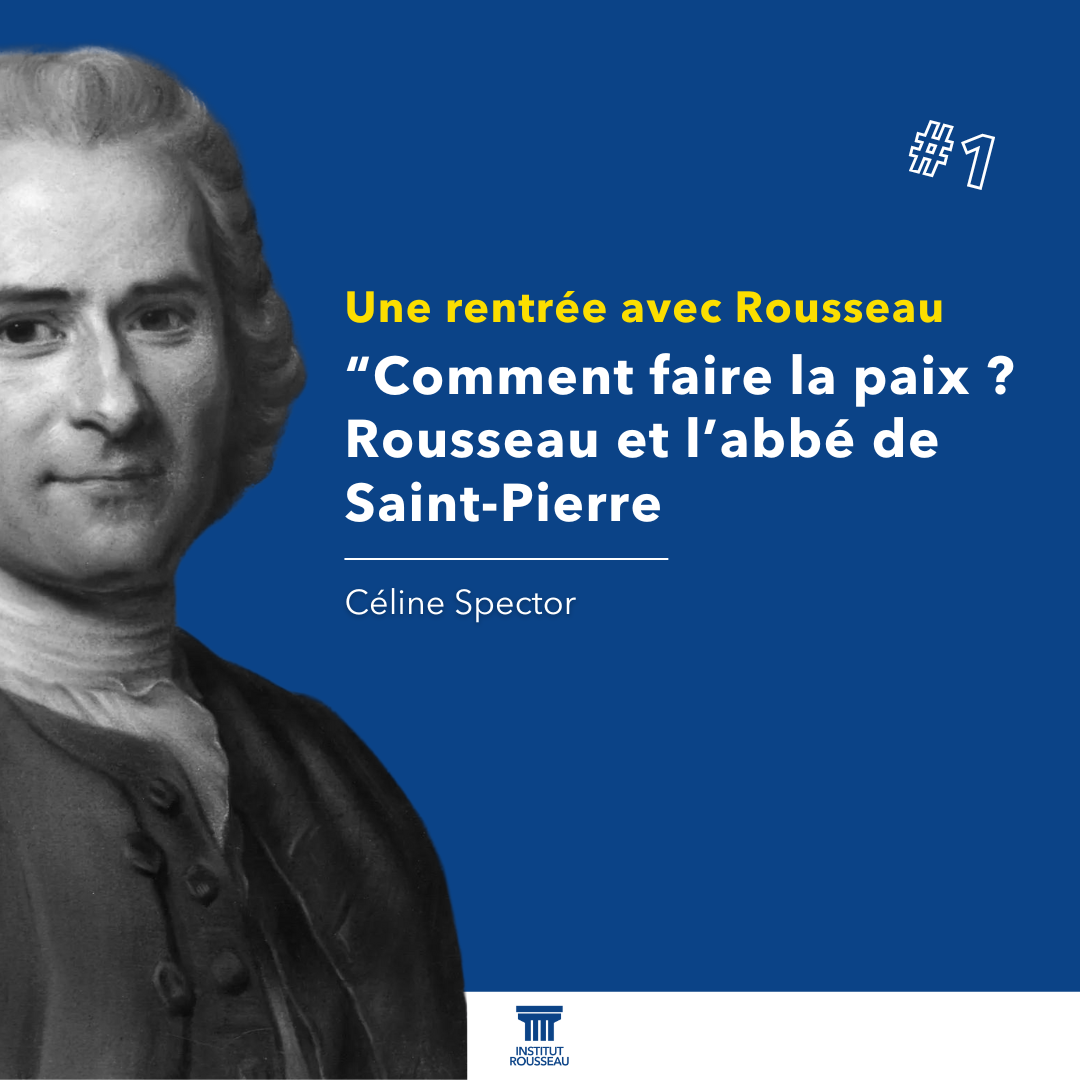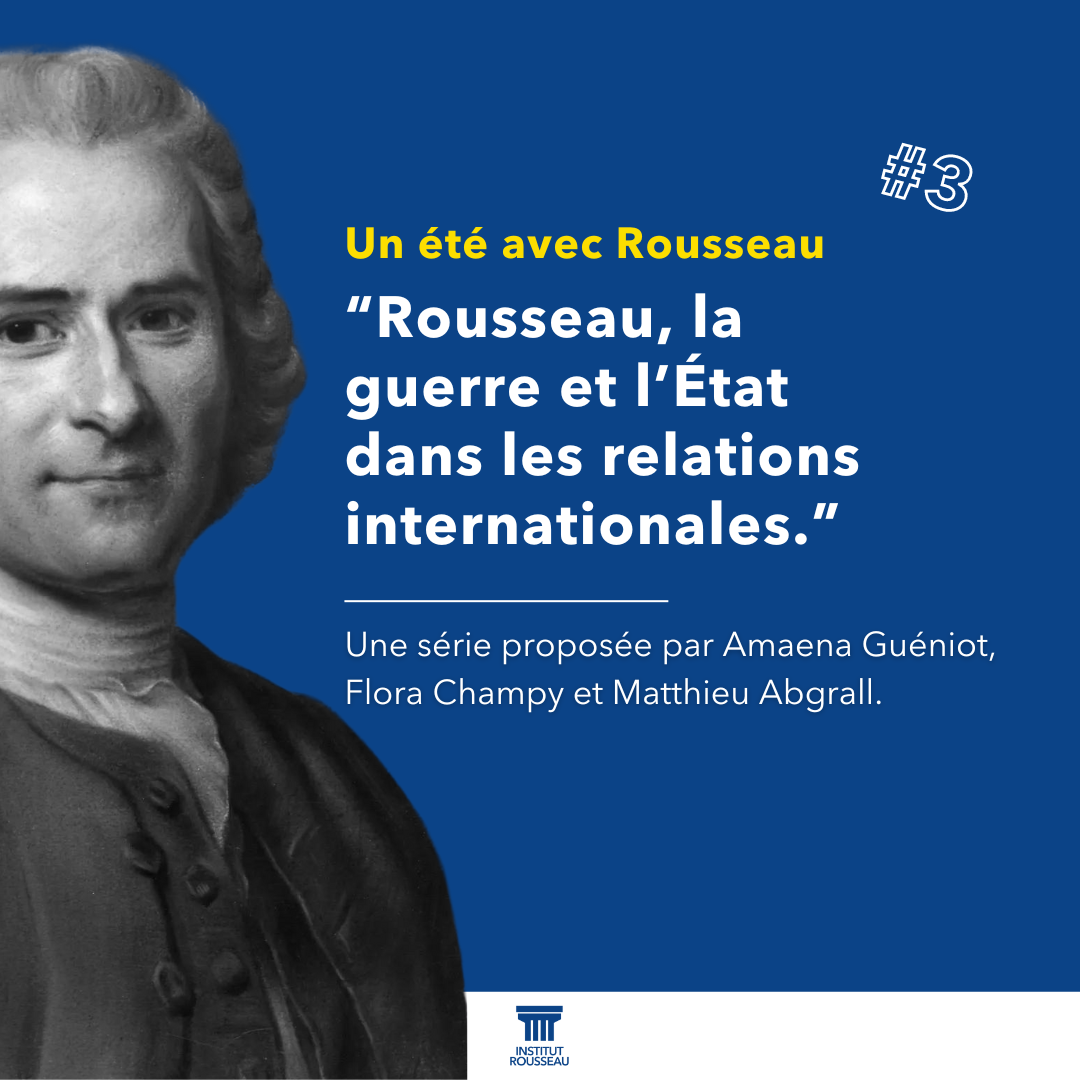Peut-on concevoir une paix durable sans démocratie ? La géopolitique dispose d’une loi connue, énoncée par le politiste américain Michael Doyle : seuls les États démocratiques sont capables d’établir et d’entretenir entre eux des liens pacifiques, alors que les dictatures sont enclines à se faire la guerre. Le contexte intellectuel dont Doyle s’inspire est celui de la philosophie des Lumières – les œuvres de l’Abbé de Saint-Pierre, Rousseau et Kant. Leur question commune est la suivante : alors que la guerre est continuelle en Europe, comment obtenir une paix qui ne soit pas seulement une trêve, mais une paix durable, « perpétuelle » ? Rousseau est un maillon décisif dans la transmission de ces idées à l’Europe. Selon lui, les républiques où la souveraineté du peuple prévaut et où la volonté générale s’exprime doivent être de petite taille – condition de l’ethos civique. Comment ne finiraient-elles pas aux prises des agressions injustes des États qui les entourent ?
Pour le comprendre, il convient de faire droit à l’Extrait du Projet de paix perpétuelle de M. l’abbé de Saint-Pierre. Dans cette œuvre parue en 1761, Rousseau engage le dialogue avec le Projet de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre, ouvrage maintes fois réédité dont la première version date de 1713[1]. Texte de commande en hommage à son illustre prédécesseur, l’Extrait n’est donc pas une œuvre parmi d’autres de Rousseau : le Citoyen de Genève tente à la fois d’y résumer et d’y approfondir les principes de l’abbé de Saint-Pierre, de mettre en valeur ses idées afin de leur donner tout leur prix[2]. L’auteur avait prévu de publier à sa suite un très critique Jugement du Projet de paix perpétuelle de M. l’abbé de Saint-Pierre, mais il y renonça finalement[3], induisant par-là un profond malentendu sur sa position à l’égard de la confédération européenne.
La confédération européenne
Le point de départ est le suivant : selon Rousseau, les hommes en ont fait « trop ou trop peu » dans les relations sociales en assurant une paix intérieure toujours mise en péril par les risques de guerres. Comment remédier, dès lors, à l’anarchie entre les États et comment sortir de l’état de guerre ? La confédération émerge d’emblée comme seule solution possible : les États européens doivent signer un Traité qui serait l’analogue, entre les peuples, du contrat social qui doit lier les individus en les soumettant également à l’autorité des lois.
Avant d’en venir à la proposition de l’abbé de Saint-Pierre, Rousseau opère cependant un détour par l’histoire. L’apport de Rousseau tient à sa vision de l’Europe. L’Extrait invoque la possibilité de confédérations pré-politiques, issues de l’union des intérêts et de la conformité des mœurs :
C’est ainsi que toutes les Puissances de l’Europe forment entre elles une sorte de système qui les unit par une même religion, par un même droit des gens, par les mœurs, par les lettres, par le commerce, et par une sorte d’équilibre qui est l’effet nécessaire de tout cela[4].
L’Europe forme un « système », soit une confédération tacite. L’ensemble des facteurs religieux, économiques, artistiques et politiques favorise l’unification de ce que Rousseau nomme une « société réelle ». Alors que l’Asie ou l’Afrique sont décrits comme une « idéale collection de Peuples qui n’ont de commun qu’un nom », l’Europe serait une « société réelle qui a sa religion, ses mœurs, ses coutumes et même ses lois »[5]
La genèse de cette société européenne peut être reconstituée : l’Empire romain forme d’abord une « union politique et civile » entre les cités-membres en communiquant aux vaincus le droit à la citoyenneté romaine et en les faisant bénéficier d’un même code de lois. À ce lien juridique s’est ajouté par la suite un autre lien social, issu du Sacerdoce et de l’Empire[6]. L’unité religieuse opérée dans l’Empire romain depuis le IVe siècle, moment où le christianisme devint religion officielle, n’aurait pas été brisée malgré le Schisme orthodoxe et la Réforme protestante.
Rousseau y ajoute une réflexion sur la situation géographique de l’Europe, « plus également peuplée, plus également fertile, mieux réunie en toutes ses parties » que tout autre continent. C’est alors « le mélange continuel des intérêts » entre souverains qui en tisse le lien, mais aussi les « communications faciles » grâce aux voies navigables ou encore « l’humeur inconstante des habitants, qui les porte à voyager sans cesse et à se transporter fréquemment les uns chez les autres » ; c’est enfin l’invention de l’imprimerie et le goût des lettres, qui crée une « communauté d’études et de connaissance ». Ce passage de l’Extrait, qui ne trouve aucun précédent chez Saint-Pierre, est crucial : Rousseau envisage ici, au-delà de la constitution d’un espace politique, celle d’un espace public ; il conçoit « une société plus étroite entre les nations de l’Europe » que dans toute autre partie du monde, dont les peuples dispersés ne sauraient s’unir en une véritable association. Aussi élabore-t-il une conception originale de la « société civile » européenne : l’Europe ne se réduit pas à une collection de souverainetés rivales ; elle est dotée d’un véritable « esprit »[7].
Mais la similitude des mœurs et l’interdépendance des nations ne suffisent pas à harmoniser les volontés. La « société réelle », en Europe, ne préjuge nullement de l’existence d’une concorde réelle entre ses peuples : guerres et révoltes caractérisent la société civile corrompue, si bien que ce qui pourrait être ferment d’union devient germe de discordes et de contradictions réelles. En l’absence de lois pour réguler leurs conflits, les États s’affrontent pour faire prévaloir leurs intérêts et entrent en rivalité pour leurs droits. Le paradoxe est là : en Europe, les divisions sont d’autant plus funestes que les liaisons entre les nations sont plus intimes. L’indétermination des frontières suscite la perpétuation de l’état de guerre. Dès lors, comment établir un art politique perfectionné, et trouver le remède dans le mal ?
Afin de concevoir une union pacifique, Rousseau exclut d’abord plusieurs solutions : l’empire ou la « monarchie universelle », l’« équilibre européen », le « doux commerce » qui compte sur la pacification par les échanges[8]. L’empire est despotique, l’équilibre toujours instable, le doux commerce illusoire. Il faut donc sortir de l’état de nature par l’institution d’un nouvel ordre politique et juridique entre États : « former une confédération solide et durable » suppose d’instituer une dépendance totale entre les membres[9]. Mais la question est de savoir comment achever par la volonté l’ouvrage commencé par le hasard : « comment la société libre et volontaire, qui unit tous les États européens, prenant la force et la solidité d’un vrai Corps politique », peut-elle se transformer en une « confédération réelle »[10] ?
Rousseau demeure fidèle ici à l’esprit de l’Abrégé du Projet de paix perpétuelle de Saint-Pierre. Il s’agirait d’abord de profiter de l’institution déjà existante des Diètes générales où se rendaient déjà les États d’Europe, instituées notamment lors des traités de Westphalie et d’Utrecht. Dans le cadre de ce Congrès des « Plénipotentiaires du corps européen », le projet consisterait à faire signer un traité de confédération formulé en cinq articles.
- Le premier article proposerait l’établissement d’une alliance perpétuelle et irrévocable entre les Souverains contractants, alliance soutenue par un Congrès permanent au sein duquel tous les différends seraient réglés par voie d’arbitrage.
- Le second article stipulerait les modalités de la présidence tournante, la quotité des contributions et les modalités de prélèvement de l’impôt destiné à financer les dépenses communes.
- Le troisième garantirait aux souverains la possession et le gouvernement de tous les États qu’ils possèdent actuellement, de même que la modalité de succession.
- Le quatrième article spécifierait les cas où tout infracteur du traité serait mis au ban de l’Europe et proscrit comme ennemi public. Ce même article prévoit une défense commune et une action destinée à obtenir l’exécution des jugements de la Diète, la réparation des torts commis et la compensation des frais engagés.
- Enfin, par le cinquième article, les représentants des États seraient habilités à voter des règlements en vue de l’avantage commun de la « République européenne » et de chacun de ses membres grâce à une procédure différenciée selon l’importance des cas : majorité simple ou qualifiée (trois quarts des voix nécessaires après la proposition de loi faite à la majorité), sachant que le traité lui-même ne pourrait être amendé qu’à l’unanimité.
En réalité, l’auteur de l’Extrait fait subir d’importantes modifications à l’énoncé des cinq articles présents dans l’Abrégé du Projet de paix perpétuelle de Saint-Pierre. Alors que Saint-Pierre proposait une ligue des rois pour la défense du statu quo territorial, Rousseau semble vouloir fédérer les peuples souverains, estimant qu’une confédération ne peut s’établir qu’entre des nations égales et maîtresses de leurs destins. Sans doute est-il délicat de savoir si le philosophe joue réellement de l’ambiguïté de l’expression souverains pour faire passer ses idées « sous le manteau » de Saint-Pierre[11]. Mais ce qui importe est qu’il ait pu prendre au sérieux la possibilité d’une confédération défensive européenne qui ne mettent pas en péril les souverainetés associées.
Il reste toutefois une question en suspens, qui va s’avérer décisive : celle qui regarde l’avantage des parties contractantes. Le parti pris est réaliste : il faut montrer que les souverains auraient intérêt, non seulement à la paix, mais à la paix instituée par le moyen de la Confédération européenne. Pourquoi accepteraient-ils de se défaire volontairement d’une partie de leur souveraineté, et de substituer une interdépendance au système d’« indépendance absolue » qui les régissait jusqu’alors ? Rousseau récuse ici l’argument de Saint-Pierre : il n’existe aucun « dédommagement » qui justifie que les princes se délestent d’une part de leur souveraineté, et notamment du droit de faire la guerre.
Le Jugement sur le Projet de paix perpétuelle, où Rousseau s’exprime à découvert, manifeste un scepticisme plus grand encore : dans les circonstances de domination des monarchies absolues, l’institution d’une confédération européenne est manifestement hors d’atteinte. Car les souverains désireux d’accroître leur puissance se trompent sur les moyens adéquats à cette fin : emportés par l’amour-propre et le désir de domination, ils se leurrent sur leur intérêt véritable.
La conclusion du Jugement est donc à double détente. S’il se réalise, le corps politique européen durera « éternellement ». Les doutes portent sur la possibilité de son instauration dans le contexte politique du XVIIIe siècle. Pour que la mise en œuvre du projet puisse être envisagée, il faudrait soit la médiation d’un négociateur hors pair, soit la transformation des États membres de la confédération afin qu’ils ne soient plus régis par des gouvernements despotiques. Pour Rousseau, avant Kant, la républicanisation des États pourrait être le préalable à la réalisation d’une confédération entre les peuples d’Europe[12]. Mais une telle transformation des monarchies en républiques lui semble hors d’atteinte : la révolution lui apparaît comme une voie exceptionnelle et dangereuse. Comme Montesquieu, Rousseau juge donc utopique l’idée de confédération européenne qui relève de la chimère et de l’esprit de système. Saint-Pierre aurait succombé, au fond, à la « folie de la raison »[13].
Article qui pourrait vous intéresser :
[1] Abbé Castel de Saint Pierre, Projet de paix perpétuelle, Paris, Fayard, 1986. Nous reprenons ici les acquis de Céline Spector, « Le Projet de paix perpétuelle : de Saint-Pierre à Rousseau », in Rousseau, Principes du droit de la guerre. Écrits sur la Paix Perpétuelle, B. Bachofen et C. Spector dir., B. Bernardi et G. Silvestrini éds., Paris, Vrin, 2008, p. 229-294.
[2] Rousseau, Confessions, livre IX, OC I, p. 422-423.
[3] Le Jugement fut publié en 1782 de façon posthume dans l’édition des Œuvres complètes de Moultou et Du Peyrou.
[4] Rousseau, Extrait du Projet de paix perpétuelle de M. l’abbé de Saint Pierre, in Principes du droit de la guerre. Écrits sur la Paix Perpétuelle (désormais Extrait), op. cit., p. 89.
[5] Ibid., p. 91.
[6] Ibid.
[7] Voir Bruno Bernardi, « Rousseau et l’Europe : sur l’idée de société civile européenne », in Rousseau, Principes du droit de la guerre. Écrits sur l’abbé de Saint-Pierre, op. cit., p. 295-330.
[8] Sur ce concept, voir Albert O. Hirschman, Les Passions et les Intérêts, trad. P. Andler, Paris, P.U.F., 1997.
[9] Ibid., p. 98.
[10] Ibid.
[11] Voir l’article où nous discutons cette hypothèse : « Le Projet de paix perpétuelle : de Saint-Pierre à Rousseau », art. cit., p. 229-294.
[12] Voir Frédéric Ramel et Jean-Pierre Joubert, Rousseau et les relations internationales, Paris et Montréal, L’Harmattan, 2000, p. 31.
[13] Montesquieu, Mes Pensées, in Mes Pensées et le Spicilège, L. Desgraves éd., Paris, Robert Laffont, 1991, n° 1718.